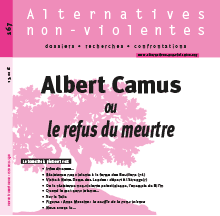À propos de la pièce de théâtre Les Justes.
« En février 1905, à Moscou, un groupe de terroristes appartenant au parti socialiste révolutionnaire, organisait un attentat à la bombe contre le grand-duc Serge, oncle du tsar ». C’est à partir de ce fait historique que Camus propose dans sa pièce de théâtre Les Justes (1950) une réflexion sur la violence révolutionnaire et plus particulièrement sur la question du meurtre. La fin justifie-t-elle tous les moyens ?
Dès l’avant-propos, il n’y a pas d’ambiguïté sur la justesse de la cause — la « juste révolte » — des acteurs de ce drame, dont il faut garder à l’esprit qu’ils ont tous existé réellement et agi comme la pièce le montre. Tout le tragique va consister dans l’articulation de cette juste révolte avec les moyens pour la mettre en actes, dans « les efforts démesurés » que vont faire les personnages pour « se mettreen accordavec le meurtre». Est résumée ici la tension qui va faire tout l’intérêt de l’œuvre. Comment la justice peut-elle s’accommoder du meurtre ?
Révolutionnaires… par amour ou par devoir ?
Dans le premier acte, on assiste à la préparation de l’attentat à la bombe contre la calèche du grand-duc. Mais surtout à la rencontre difficile entre Stepan et Kaliayev, qui incarnent chacun — et presque jusqu’à la caricature parfois — le prototype d’attitudes opposées face à la révolution.
Kaliayev est sans doute le vrai héros de la pièce. Il incarne un style de révolutionnaire convaincu et prêt au sacrifice, certes, mais également joyeux, joueur. « Je suis entré dans la révolution parce que j’aime la vie », déclare-t-il.
« Je n’aime pas la vie, mais la justice qui est au-dessus de la vie, rétorque Stepan. Je suis venu pour tuer un homme, non pour l’aimer. » Révolutionnaire intransigeant, dur, sérieux, il est mû par le devoir et par la haine, et fait l’éloge de l’obéissance à la discipline. Pour lui rire, jouer, célébrer sont des pertes de temps inutiles.
« Et pourtant, nous allons donner la mort »
C’est Dora, camarade de révolution, qui introduit la problématique de la contradiction possible entre le meurtre et l’amour de la vie. Alors que Kaliayev lui déclare : « J’aime la beauté, le bonheur ! C’est pour cela que je hais le despotisme. (…) La révolution, bien sûr ! Mais la révolution pour la vie, pour donner une chance à la vie, tu comprends ? », celle-ci réplique : « Oui… Et pourtant, nous allons donner la mort. » Cette contradiction est d’abord balayée par Kaliayev : « Oh non, ce n’est pas la même chose. Et puis, nous tuons pour bâtir un monde où plus jamais personne ne tuera ! Nous acceptons d’être criminels pour que la terre se couvre enfin d’innocents. »
Plus loin, il concède : « Une pensée me tourmente : ils ont fait de nous des assassins. Mais je pense en même temps que je vais mourir, et alors mon cœur d’apaise. Je souris, vois-tu, et je me rendors comme un enfant. » « Mourir pour l’idée, c’est la seule façon d’être à la hauteur de l’idée. C’est sa justification. » Le sacrifice de sa vie — dans l’attentat ou plus tard par la pendaison qui l’attend — vient, par sa grandeur et son courage, justifier le meurtre et compenser la laideur morale de ce dernier.
Mais de nouveau Dora, sa camarade, le met en garde contre une « défaillance » qui pourrait l’empêcher d’accomplir à bien sa mission, et introduit le doute au cœur de l’action :
« Au premier rang, tu vas le voir…
Qui ?
Le grand-duc. Une seconde, à peine.
Une seconde où tu le regarderas. Oh, Yanek, il faut que tu saches, il faut que tu sois prévenu ! Un homme est un homme. Le grand-duc a peut-être des yeux compatissants. Tu le verras se gratter l’oreille ou sourire joyeusement. (…) Et s’il te regarde à ce moment-là…
Ce n’est pas lui que je tue. Je tue le despotisme. »
Ce n’est que par le déni de la matérialité de son acte que Kaliayev parvient provisoirement à résoudre la contradiction.
Assassiner des enfants pour faire triompher la vie ?
Le deuxième acte nous emmène le lendemain, dans le repaire des « terroristes », au moment prévu pour l’attentat. Kaliayev revient bredouille. Il n’a pas lancé la bombe, car « il y avait des enfants dans la calèche du grand-duc ». « Je ne pouvais pas prévoir… Des enfants, des enfants surtout. As-tu regardé des enfants ? »
« L’organisation t’avait commandé de tuer le grand-duc », dénonce Stepan. « C’est vrai. Mais elle ne m’avait pas demandé d’assassiner des enfants. »
«Pourrais-tu, toi, Stepan, tirer à bout portant sur un enfant ?, l’interroge Dora.
Je le pourrais si l’Organisation le demandait.
(…) Ouvre les yeux et comprends que l’Organisation perdrait ses pouvoirs et son influence si elle tolérait, un seul moment, que des enfants fussent broyés par nos bombes.
Je n’ai pas assez de cœur pour ces niaiseries. Quand nous nous déciderons à oublier les enfants, ce jour-là, nous seront les maîtres du monde et la révolution triomphera.
Ce jour-là, la révolution sera haïe de l’humanité entière. »
Avec ce dialogue entre Dora et Stepan, nous sommes au cœur du débat sur l’emploi et le consentement à la violence au service d’idées généreuses. Y a-t-il des limites à la violence que nous pouvons utiliser pour servir une cause juste, à partir desquelles l’inhumanité des moyens utilisés vient pervertir la fin elle-même ?
Pour tuer, il faut être « sûr » d’être « dans son droit »
Dans un second temps de l’acte II, les protagonistes débattent sur l’opportunité de lancer ou non la bombe sur le grand-duc et ses neveux à leur sortie du théâtre.
« Des enfants ! Vous n’avez que ce mot à a bouche, s’insurge Stepan. Ne comprenez-vous donc rien ? Parce que Yanek n’a pas tué ces deux-là, des milliers d’enfants russes mourront de faim pendant des années encore. Avez-vous vu des enfants mourir de faim ? Moi, oui. Et la mort par la bombe est un enchantement à côté de cette mort-là. Mais Yanek ne les a pas vus. Il n’a vu que les deux chiens savants du grand-duc. N’êtes-vous donc pas des hommes ? Vivez-vous dans le seul instant ? Alors choisissez la charité et guérissez seulement le mal de chaque jour, non la révolution qui veut guérir tous les maux, présents et à venir.
(…) Mais la mort des neveux du grand-duc n’empêchera aucun enfant de mourir de faim, réplique Dora. Même dans la destruction, il y a un ordre, il y a des limites.
Il n’y a pas de limites. La vérité est que vous ne croyez pas à la révolution. (…) Si cette mort vous arrête, c’est que vous n’êtes pas sûrs d’être dans votre droit.
(…) J’ai accepté de tuer pour renverser le despotisme, intervient Kaliayev. Mais derrière ce que tu dis, je vois s’annoncer un despotisme qui, s’il s’installe jamais, fera de moi un assassin alors que j’essaie d’être un justicier. »
Le propos de Stepan est révélateur de l’attitude psychologique nécessaire à l’emploi de la violence : la certitude d’avoir raison. S’il n’était pas sûr d’être dans son droit, s’il était dans le doute quant à la justesse de sa cause, Stepan ne pourrait pas justifier le meurtre au nom de cette cause avec un tel aplomb. On retrouve ici une intuition fondamentale de la non-violence gandhienne : la non-possession de la vérité. Si je pouvais posséder la vérité, je pourrais peut-être trancher des têtes, mais ne pouvant être dans la certitude que j’ai raison et que mes adversaires ont tort, je ne peux qu’en déduire une attitudeelle-même prudente et aux conséquences réversibles, que Gandhi appelle non-violence 1 .
Sacrifier le présent à un futur hypothétique ?
Si Kaliayev refuse de jeter la bombe sur des enfants, c’est qu’au contraire de Stepan, il est conscient de ne pouvoir avoir de certitude totale quant à l’avenir et aux conséquences historiques de ses actes. « Mais moi, j’aime ceux qui vivent aujourd’hui sur la même terre que moi, et je les salue. C’est pour eux que je lutte et que je consens à mourir. Et pour une cité lointaine, dont je ne suis pas sûr, je n’irai pas frapper le visage de mes frères. Je n’irai pas ajouter à l’injustice vivante pour une justice morte. » Le doute est un élément déterminant de son choix. Mais aussi la contradiction qu’il voit dans le fait de sacrifier le présent au profit d’un futur incertain. On rejoint ici les intuitions de la non-violence 2 .
Finalement, le groupe prend la décision de reporter l’attentat à un moment où le duc se trouvera seul dans sa calèche.
Le meurtre est-il assumable ?
Dans le troisième acte, nous assistons au désistement de Voinov, qui ne se sent pas capable de lancer la bombe, et au départ pour l’attentat de Kaliayev, alors que le grand-duc va se trouver seul dans sa calèche.
La question du meurtre revient, lancinante, comme un leitmotiv, avec l’acte IV, alors que l’on retrouve Kaliayev en prison suite à son attentat « réussi ». D’abord dans le face-à-face du révolutionnaire avec un autre prisonnier, Foka. Quand ce dernier découvre qu’il sera le bourreau de Kaliayev, il tente de fuir son tête-àtête avec lui. Comme si le meurtre, dans sa dimension humaine, était inassumable. On est tenté de rejoindre ce faisant les méditations du philosophe Lévinas, sur l’impossibilité du meurtre après le face-à-face : le visage d’autrui interdit le meurtre, il est en lui-même, de par sa vulnérabilité, un « Tu ne tueras point ».
Puis Skouratov, directeur de la police, joue avec la conscience morale de Kaliayev et son sentiment de culpabilité, pour le fragiliser. En jouant avec la « faille » éthique du prisonnier, Skouratov lui pose une question qui pousse jusqu’au bout les conséquences de son raisonnement : « Une question se pose : si l’idée n’arrive pas à tuer les enfants, mérite-t-elle qu’on tue le grandduc ? » À travers cette question c’est l’horizon éthique de la non-violence qui est effleuré par Camus.
Enfin c’est la grande-duchesse elle-même qui vient rencontrer le meurtrier de son mari. Kaliayev se trouve alors confronté aux conséquences humaines, à la douleur et à la dévastation qu’a causé son meurtre du grand-duc sur une personne qui l’aimait. Il est comme forcé à regarder en face la réalité de l’acte qu’il a accompli. Il tente encore une fois de se défausser en souhaitant mourir au plus vite, mais la grande-duchesse juge cela «trop facile». « Mourir ? Tu veux mourir ? Non. (…) Tu dois vivre, et consentir à être un meurtrier. » C’est depuis ce cachot sombre que Camus nous entraîne à la conclusion que ce n’est pas la mort qui ne peut pas être regardée en face, mais le meurtre.
Sur les chemins de la non-violence…
Dans le cinquième et dernier acte, qui expose la discussion entre les camarades de Kaliayev la nuit de son exécution, la question du doute est inlassablement soulevée par Dora :
- « Si la seule voie est la mort, nous ne sommes pas sur la bonne voie. La bonne voie est celle qui mène à la vie, au soleil. On ne peut avoir froid sans cesse…
-Celle-là mène aussi à la vie,rétorque Annenkov. À la vie des autres. (…)
-Les autres, nos petits-enfants… Oui. Mais Yanek est en prison et la corde est froide. Il va mourir. Il est mort peut-être déjà pour que les autres vivent. Ah, Boria, et si les autres ne vivaient pas ? Et s’il mourait pour rien ?
-Tais-toi. »
Ce « tais-toi » montre une fois encore que le doute n’est pas permis, qu’il est incompatible avec le meurtre, avec le sacrifice du présent au profit de l’avenir.
Dans cette pièce, Camus refuse de conclure, mais il s’enfonce sans complaisance dans la contradiction du révolutionnaire entre les moyens utilisés et les fins poursuivies, en soulignant son caractère insoutenable. Il ne conclut pas au refus catégorique du meurtre, et en cela il est impossible de faire de l’écrivain un apôtre de la « non-violence ». Mais il vient « décortiquer » et approfondir sans concession la contradiction et la tragédie du révolutionnaire confronté à la possibilité de l’emploi de la violence, du meurtre. Camus, à la différence de nombreux idéologues du XXe siècle, aura eu le grand mérite de refuser de fermer les yeux sur cette contradiction fondamentale. Il ose regarder la question du meurtre en face. Ce faisant, sa lecture est certainement une rencontre déterminante qui vient nous éclairer de manière unique sur les chemins de la non-violence.
1) C’est le même constat que fait la sociologue Irène Pereira dans son analyse des modes d’action avant et après Mai 1968 liés au passage d’un militantisme dogmatique à un militantisme pragmatique : « Le fait de ne pas posséder une science de l’histoire qui nous justifierait de nos actes et qui nous donnerait une connaissance de la fin de l’histoire (…) a plusieurs conséquences. Cela suppose que l’on recherche une certaine continuité entre les fins et les moyens dans la mesure où nous ne sommes pas assurés que nos moyens seront justifiés par la fin que nous poursuivons. Cette continuité entre les fins et les moyens a deux conséquences. Elle nous amène à rechercher la mise en place de pratiques démocratiques au sein de nos organisations militantes. Elle nous conduit à faire un usage prudent de la violence. » (Silence n° 362, « Les écologistes peuvent-ils s’inspirer de Mai 68 ? »).
2) Telles que les formule Jean-Marie Muller lorsqu’il parle de la relation entre les fins et les moyens : « Dans le moment présent, nous ne sommes pas maîtres de la fin que nous recherchons, nous ne sommes maîtres que des moyens que nous utilisons –ou, plus exactement, nous ne sommes maîtres de la fin que par l’intermédiaire des moyens. La fin est encore abstraite, alors que les moyens sont immédiatement concrets. » (Le courage de la non-violence, Le Relié, 2001).