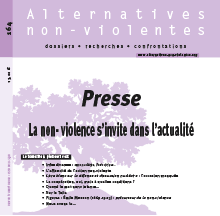L’information en temps de guerre ne pose pas des problèmes très différents de l’information ordinaire. Elle les pose seulement de manière plus visible et plus dramatique.
Jérôme-Alexandre NIELSBERG : La guerre du Golfe en 1991 avait révélé un certain nombre de dysfonctionnements médiatiques. Presque vingt ans après, la couverture de la guerre d’invasion que la coalition américano-britannique a menée contre l’Irak vous semble-t-elle avoir été effectivement mieux conduite ?
Patrick CHAMPAGNE : La couverture journalistique de la guerre du Golfe était très visiblement contrôlée par les autorités politiques et militaires, françaises et surtout américaines. La guerre du Vietnam avait profondément traumatisé les Américains qui étaient persuadés d’avoir perdu la guerre moins du fait des Vietcongs que du fait de sa médiatisation quasi quotidienne. Les images de guerre, toujours plus ou moins atroces, auraient pesé sur le moral des Américains. Je ne sais pas si cela est vrai, et dans quelle mesure, mais c’est ce que les militaires ont cru. Et cela explique en grande partie le fait que les Américains aient voulu très strictement contrôler les images de la guerre lors de leur intervention dans le Golfe. Mais comme ils en ont fait un peu trop, que la propagande était un peu trop visible (on voyait très peu de cadavres, ce qui est un comble s’agissant d’une guerre), cela a suscité très naturellement des critiques chez les journalistes et au-delà.
Lors des interventions militaires qui ont suivi, en Bosnie, au Kosovo, en Irak et aujourd’hui en Afghanistan, les militaires ont dû faire croire à plus de transparence dans l’information. C’est que, à chaque fois, à chaque crise couverte par les journalistes, il y a eu des réflexions sur la pratique journalistique. Un peu sans doute dans le public mais surtout chez les journalistes eux-mêmes. Il faut prendre en compte, en particulier, le fait que le journalisme est un milieu dans lequel il y a une réflexion collective, dans lequel le débriefing est permanent : les journalistes se lisent, se critiquent, se jugent sans cesse, entre autres parce qu’ils sont en concurrence. Et le journalisme ne peut donc ignorer son histoire la plus récente, la dénonciation médiatique de ses erreurs, les manipulations dont il a été l’objet.
J.-A. N. : L’autocritique est nécessaire, mais faut-il aussi qu’elle soit publique ?
P.C. : Ce retour sur l’information est important parce que la presse, du moins celle qui se veut sérieuse, y joue sa crédibilité auprès de ses lecteurs. Et les journalistes eux-mêmes, c’est leur point d’honneur, se veulent « professionnels », c’est-à-dire autonomes. Ils ne veulent pas être les instruments dociles d’une propagande grossière.
Signe des temps, il est intéressant à cet égard de noter que la couverture des conflits majeurs par la presse comporte de plus en plus d’émissions ou d’articles sur la manière dont les journalistes travaillent sur le terrain. C’est que les médias doivent clairement manifester qu’ils sont vigilants à l’égard des tentatives de manipulations des autorités, que cette fois il faut les croire, ils sont crédibles ou du moins plus crédibles que lors du dernier conflit. En ce qui concerne la guerre contre l’Irak, les facilités apparentes qui ont été données aux journalistes pour couvrir le conflit n’étaient pas très risquées sur le plan de la guerre de l’information qui est toujours présente dans l’information en temps de guerre : la disproportion des moyens militaires entre Américains et Irakiens — un marteau-pilon contre un moustique — était telle que les pertes prévisibles de la coalition n’étaient pas a priori telles qu’elles auraient pu risquer de démoraliser ceux qui soutenaient cette intervention. En définitive, la manipulation est toujours présente. Elle est seulement de plus en plus subtile et ajustée à chaque conflit. Il n’était pas possible que les Américains, cette fois-ci, imposent aux journalistes les mêmes conditions que lors de la guerre du Golfe. Et comme ils ont besoin de la presse pour peser sur l’opinion publique, ils composent avec elle.
J.-A. N. : Justement, l’incrustation des reporters dans les forces armées coalisées vous paraît-elle relever d’une pratique journalistique totalement nouvelle, comme cela a été dit ?
P.C. : Non, cela n’est pas nouveau. Depuis longtemps déjà les journalistes sont intégrés, accompagnent les militaires pour ramener des images ou faire des reportages, et aussi se font tuer. C’est ce que l’on appelle classiquement les correspondants de guerre. Les premiers reporters furent précisément des correspondants de guerre. Ce qui est peut-être nouveau ici, c’est le nombre des journalistes — pas tous correspondants de guerre — qui sont présents sur le terrain et que les militaires américains emmènent avec eux.
Mais ce qui est surtout nouveau, c’est le fait qu’aujourd’hui l’information couvre en direct les opérations et risque donc de peser sur leur déroulement. D’où les contrôles et la manipulation plus ou moins subtile que chaque camp exerce sur les médias. Quant aux problèmes déontologiques et éthiques que cela pose, je pense qu’il est un peu naïf de croire qu’il soit possible d’informer « objectivement » en temps de guerre. L’information en temps de guerre est une chose trop importante pour être laissée aux seuls journalistes. Et donc on imagine mal que les militaires acceptent que les journalistes puissent travailler contre eux en aidant, volontairement ou non, l’ennemi et que des opérations militaires puissent échouer ou soient très meurtrières sous le prétexte que l’information serait une chose sacrée et absolue. Les journalistes qui couvrent par exemple le conflit israélo-palestinien, notamment du côté palestinien, le savent : l’armée israélienne qui est censée être « la plus démocratique au monde » a fait de nombreuses victimes parmi ces derniers, et pas toujours involontairement. Pourtant, à bien y réfléchir, l’information en temps de guerre ne pose pas des problèmes très différents de l’information ordinaire. Elle les pose seulement de manière plus visible et plus dramatique.
J.-A. N. : Est-ce à dire que l’information quotidienne en tant de paix relèverait des mêmes enjeux ?
P.C. : L’actualité la plus banale pose chaque jour les mêmes problèmes que ceux d’une crise mais ils sont comme évacués par la routine même du travail d’information, qui fait l’essentiel de l’activité de la plupart des journalistes. Aller ou non à une conférence de presse au ministère de l’Intérieur ou de la Santé par exemple, en rendre compte et comment, ne pose pas moins de questions que d’aller à une conférence de presse donnée par tel général durant les opérations militaires : qui cela intéresse-t-il ? Qui se sert de l’information ? De quoi ne parlet-on pas ? Par exemple, que sait-on sur la situation actuelle en Afghanistan, sur les promesses de reconstruction du pays par les Américains, etc. ? En fait, ce qui me paraît le plus important, s’agissant de comprendre la production de l’information, c’est que les journalistes n’en sont que les producteurs apparents. L’information est un produit collectif. Le journaliste est le point d’application de contraintes multiples, son travail étant en quelque sorte la résultante de toutes les forces qui pèsent sur lui. Un journaliste ne produit pas indépendamment des autres journalistes, ni des stratégies de manipulations des autorités, ni de la rédaction en chef qui veille au respect de la ligne éditoriale, ni du public auquel il s’adresse, ni de ce qui semble politiquement correct (du moins à ses yeux), etc. C’est sans doute ce que les journalistes veulent dire lorsqu’ils se défendent contre les critiques en disant que « chaque société a finalement la presse qu’elle mérite ».
Sans doute tout journaliste a-t-il sa petite marge d’autonomie ou, si l’on veut, de liberté. Mais c’est une liberté conditionnelle car il n’est, pour une large part, que l’écrivain ou le porte-plume de sa société et il n’est libre d’écrire que ce que ses lecteurs veulent lire. Les journalistes des grands médias audiovisuels notamment sont condamnés à produire l’information qui sera la plus consensuelle, c’est-à-dire celle qui provoquera le moins de réactions virulentes de la part des téléspectateurs qu’il ne faut pas choquer, mais aussi de la part des autres journalistes de la presse écrite qui sont vigilants et dénoncent les « dérapages » de la télévision.
J.-A. N. : La liberté de la presse des démocraties serait-elle une fable ?
P.C. : Contrairement à une idéologie professionnelle très prégnante dans le milieu, un journaliste « libre » n’est pas un journaliste qui peut écrire ce qu’il veut mais un journaliste qui écrit ce qu’« on » veut qu’il écrive et qui en est content. La question est de savoir qui est ce « on ». Ce « on » désigne en fait un ensemble de contraintes collectives auxquelles le journaliste doit s’ajuster. Le journaliste occupe, en effet, une position dans un champ de production, le champ journalistique, et écrit pour son public, c’est-à-dire pour un public déterminé, tout en regardant ce qu’écrivent les autres journalistes qui participent également au processus de production de l’information. Comme un ouvrier dans une chaîne de montage, le journaliste est un travailleur intellectuel qui occupe un poste de travail et doit accomplir ce que la définition du poste exige. C’est précisément parce qu’il le fait, et le fait bien, qu’il a été embauché, qu’il reste à son poste et qu’il est apprécié par ses lecteurs et par sa rédaction en chef. Dans le cas contraire, il est remercié ou changé de service ou alors il va chercher du travail ailleurs, dans un autre journal qui sera plus conforme — politiquement, culturellement — à ce qu’il est.
La seule question qui se pose est donc de savoir si un journaliste est bien à sa place compte tenu de ce qu’il est, de ce qu’il sait faire et de ce qu’il a envie de dire. Si vous êtes « de gauche » et opposé au néolibéralisme, il vaut mieux être journaliste à L’Humanité qu’au Figaro, et réciproquement. Vous vous sentirez plus « libre » tout simplement parce que vous serez en phase avec ce que vous voulez écrire ou faire et ce que le journal et ses lecteurs veulent lire de votre part. En d’autres termes, la liberté, pour un journaliste, mais pas seulement, c’est ce qui est ressenti lorsque l’on occupe la position qui est la plus conforme à ce que l’on est et qui fait que l’on se comporte (ou que l’on pense) comme il convient, sans qu’il soit nécessaire qu’une autorité quelconque vous rappelle à un ordre qui n’est pas le vôtre. En fait il est très difficile de penser le journalisme comme une activité sociale comme une autre parce que des intérêts politiques, idéologiques et aussi narcissiques très puissants s’y opposent. (…)
Entretien réalisé par Jérôme-Alexandre NIELSBERG