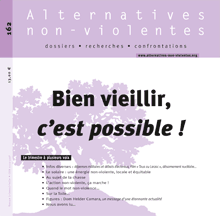Le livre de Jacques Pohier, La mort opportune (Seuil), continue de susciter de nombreuses controverses. Contre l’acharnement thérapeutique et les fins de vie indignes, l’auteur propose que chacun puisse choisir en conscience les modalités de sa mort.
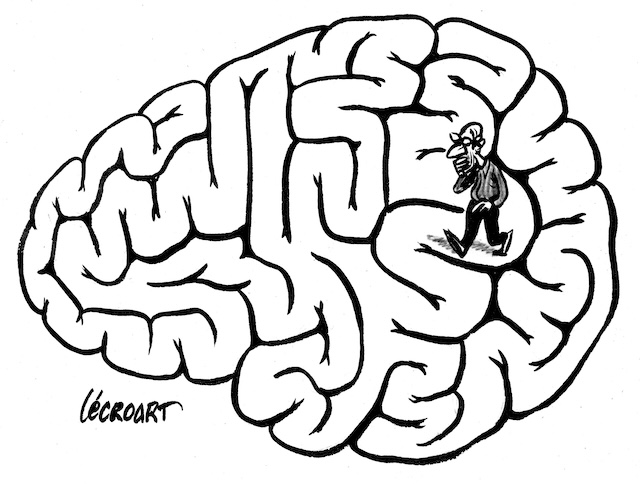
ANV : Qu’entendez-vous par euthanasie volontaire ?
Jacques Pohier : L’euthanasie n’est pas d’abord un problème médical. C’est un problème du rapport du sujet avec lui-même et avec sa propre mort. C’est là que se situe le problème de l’euthanasie. Il en va de même avec la contraception ou l’interruption de grossesse ; l’interruption de grossesse n’est pas un problème médical. C’est une décision que prend une femme, avec éventuellement son compagnon. Elle ne la prend pas forcément pour des raisons médicales. Ce n’est pas au médecin de juger. Le médecin est un auxiliaire. Il est là, et c’est lui qui fait l’interruption de grossesse. Ce n’est pas lui qui la décide. Pour l’euthanasie volontaire, c’est la même chose.
Je donne souvent l’exemple de cette amie qui avait un cancer du sein, qu’on a opérée et qui a fait de la radiothérapie. Elle a dit : « Moi, je ne veux pas m’embarquer dans la série des chimiothérapies de plus en plus douloureuses, de plus en plus inefficaces. » C’était sa mort à elle. Elle avait décidé qu’elle demanderait l’euthanasie si les métastases reprenaient. Elle avait le choix entre l’euthanasie, quelque chose qui est pratiqué par un médecin, et le suicide assisté.
J’insiste beaucoup sur le fait que l’euthanasie ne doit être qu’un choix personnel. Ce n’est pas un choix entre la vie et la mort, mais un choix entre deux façons de mourir. Quand des personnes commencent à trop vieillir, à descendre l’escalier de l’âge, certaines décident d’aller jusqu’au bout, même au-delà du bout, demandant un acharnement thérapeutique maximal ; d’autres ne veulent pas descendre l’escalier jusqu’au bout. Ça n’a rien d’agressif vis-à-vis du médecin, ni même de l’entourage. Je trouve que la personne qui décide d’arrêter avant la fin, alors que la fin est bien connue, elle choisit entre une façon de mourir et une autre. Pourquoi le médecin ne pourrait-il pas être l’auxiliaire de la façon de mourir choisie par le patient ?
L’euthanasie volontaire est un acte médical, mais ce n’est pas une décision médicale. Ce n’est pas au médecin de décider d’une euthanasie. C’est pour cela qu’il ne faut pas poser le problème uniquement en fonction des phases terminales. Dans quelques cas où j’ai aidé des gens à mourir, une personne était en phase terminale, les quatre autres n’y étaient pas du tout, mais elles estimaient que pour elles « ça suffisait comme ça ». Elles l’estimaient d’autant plus que la loi actuelle ne leur garantit pas que leur volonté de recevoir la mort à un moment donné aurait été respectée. L’euthanasie volontaire est avant tout une décision personnelle.
ANV : Trois expressions posent problème : « mort opportune », « euthanasie » et « suicide assisté ». Pour « mort opportune », vous dites que le vrai titre aurait pu être « le temps opportun de la mort ». Personnellement j’aurais préféré ce titre. Je ne sais pas s’il y a une volonté de provocation pour faire réfléchir, ce qui est parfois une méthode utilisée par les éditeurs dans les titres. Je pense effectivement que la mort n’est jamais opportune. Seul le temps peut être opportun. Le choix, finalement, c’est le choix du moment.
J. P. : La « mort opportune» est une expression que j’ai inventée, faute de pouvoir employer l’expression latine mors tempestiva, laquelle peut se traduire par « la mort qui arrive au temps voulu ». Nous avons retenu du latin le mot « intempestif » pour désigner la chose qui arrive au mauvais moment. Mais en latin courant, un individu qui arrive à l’heure, cela se dit « tempestus ». Il arrive en temps voulu. Les événements eux-mêmes surviennent au moment souhaité. Le français n’a pas gardé ce sens. Et je ne désirais pas avoir un titre en latin !
Vous dites que la mort n’est jamais opportune ; pour ma part j’affirme souvent le contraire, car, comme je le dis dans le chapitre 2 de mon livre, la mort n’est pas une maladie. Il est opportun que nous mourions. Ce qui peut être inopportun, ce sont les conditions dans lesquelles nous mourons. Il est opportun de mourir. Je n’ai pas du tout envie de survivre comme un légume à 95 ans, aveugle, sourd et paralytique.
ANV : La différence entre euthanasie volontaire et suicide assisté réside dans la place où autrui intervient.
J.P. : Si dans un coin d’une pièce vous mettez quelqu’un à qui un médecin est en train de faire une piqure, et si de l’autre côté de la pièce vous mettez quelqu’un en train d’avaler des médicaments qu’on lui a fournis, ce n’est pas la même chose. Pourquoi le suicide a-t-il besoin d’être assisté, dans I’hypothèse où il s’agirait d’un suicide non pathologique ? Le suicide a besoin d’être assisté, parce que si l’on reconnaît à cette personne le droit de mourir, au moment où elle le juge bon, pourquoi la condamnerait-on à la solitude psychologique et sociale ? Pourquoi la condamnerait-on aux aléas d’une telle technique qui n’est peut-être pas sûre ? Pourquoi le suicide ne pourrait-il pas être socialisable ?
J’en ai parlé avec des amis qui participent à des suicides assistés aux Pays-Bas et en Suisse. Ils ne sont pas là-bas des actes clandestins. Si on considère que le suicide est un acte légitime dans certaines circonstances, il a besoin d’être aidé et éventuellement socialisé comme tous les actes humains importants. La naissance est assistée, le mariage est assisté. Tous les actes importants de la vie méritent d’être socialisés. Et si le suicide est un acte — en certaines circonstances légitime, et même à mon avis noble —, pourquoi ne pourrait-on pas le socialiser ? J’ai connu aux Pays-Bas des gens qu’on a aidés à se suicider : leurs familles étaient là, tout comme leurs amis. Ils ont fait leurs adieux. Ils ont dit au revoir aux leurs. Ils les ont embrassés. Pourquoi le suicide ne serait-il pas socialisable ?
On parle beaucoup du suicide des jeunes, mais en France comme dans la plupart des pays occidentaux, le pourcentage des suicides des personnes de plus de 80 ans est huit fois plus élevé que le pourcentage de suicides des jeunes. On parle beaucoup et on s’inquiète du suicide des jeunes, et on a bien raison. Mais les conditions dans lesquelles des personnes âgées se suicident ne sont pas toujours très belles ! Elles se suicident dans la solitude, dans la pauvreté, dans la culpabilité et aussi dans l’incertitude de leurs gestes. On n’est jamais certain que ça réussisse, sauf avec des chevrotines. Je ne sais pas si vous avez déjà ramassé les morceaux de quelqu’un qui s’est fait sauter la tête avec des chevrotines, j’aime autant vous dire qu’il y en a plein les murs. Les vieillards se suicident déjà beaucoup. Je préfèrerais qu’il y en ait beaucoup moins qui le fassent, mais pour cela il faudrait qu’ils ne soient plus abandonnés, moins dans la misère. Il y a aussi une raison très simple, plus technique, qui milite en faveur du suicide assisté : si vous ne voulez pas utiliser une méthode violente comme le coup de feu, il faut vous procurer des médicaments. Ceux-ci sont très difficiles à obtenir. Dans les pays étrangers où I’assistance au suicide n’est pas un délit — comme c’est le cas en Suisse ou dans certains États des États-Unis —, le médecin donne une prescription de médicaments, parfois c’est lui qui les fournit et les apporte. Si vous êtes, en France, une vieille femme ou un vieil homme de 90 ans, plus ou moins handicapé, comment allez-vous faire pour vous procurer tant de boîtes de tel médicament, et tant de boîtes de tel autre médicament ? Il faut qu’on vous aide.
ANV : Toutes les personnes sont-elles en mesure de s’assumer devant la mort ?
J.P.: Je suis d’accord avec vous. Il y a beaucoup de personnes qui ne pourront jamais s’assumer devant la mort. Mais pourquoi serions-nous beaucoup plus exigeants à propos de la mort qu’à propos de toutes les autres phases de la vie ? Pensez-vous que les gens qui font des enfants s’assument toujours ? Croyez que quand les gens se marient, ils assument complètement leur vie conjugale et familiale ? Je ne vois pas pourquoi on exigerait à propos du rapport avec sa propre mort, un niveau de conscience absolue que beaucoup d’humains ont si peu dans les autres actes de leur vie. Le plus difficile à admettre, c’est qu’en fait l’euthanasie volontaire ou le suicide assisté portent sur quelque chose qui n’a pas grande importance. Les adversaires ou les partisans de l’euthanasie volontaire font souvent comme si la mort était le sommet de l’existence humaine. Mais non ! J’ai connu un syndicaliste qui est mort d’un cancer généralisé et qui disait : « Moi j’ai fait dans ma vie des choses beaucoup plus importantes que de mourir. »
Quelqu’un qui veut retirer deux mois, trois mois, ou six mois à son existence, je ne pense pas que ce soit quelque chose de très important. On en fait toute une histoire ! Je cite dans mon livre ce que m’a dit une femme : « Le jour où mon mari et moi avons décidé de mettre un enfant en route, on a pris une décision bien plus importante, et qui a eu beaucoup plus de conséquences que la décision que nous avons prise de nous épargner l’un à l’autre deux ou six mois d’une vie sans grand intérêt pour nous. » C’est pour cela que je parle du besoin de démystification de l’euthanasie et du suicide assisté. On fait comme si c’était le sommet de la détermination de l’existence ! C’est faux ! C’est tout simplement un acte qui porte sur quelque chose de pas très important.
ANV : Je crois qu’il n’y a pas besoin d’être freudien pour parler d’angoisse de la mort. N’est-ce pas là finalement le problème ? Les réactions des gens sont des réactions par rapport à la peur de la mort.
J.P. : Vous citez Freud. Mais savez-vous que Freud a demandé et obtenu une euthanasie volontaire ? Il avait subi de nombreuses opérations à cause d’un cancer dans une mâchoire qui l’a fait horriblement souffrir. Qu’est-ce qui l’a décidé à demander à son ami, le docteur Schur, de l’aider ? C’est quand son chien n’a plus voulu vivre auprès de lui, car il était dégoûté par l’odeur que dégageait son maître.
La mort n’est pas une maladie, c’est une étape naturelle de l’existence. Nous sommes les premiers êtres humains, dans l’histoire de l’humanité, à pouvoir constater de nos yeux que la vie commence, grandit, diminue et puis se termine. Tout cela est naturel. Parce que mourir est une étape naturelle de l’existence, aider à mourir n’est pas du tout aider à tuer. Aider à mourir, c’est du même genre qu’aider à naître, à respirer, à marcher. Aider à mourir n’est pas du tout la même chose que tuer.
ANV : Comment est née l’ADMD (Association pour le droit de mourir dans la dignité) ?
J.P. : Cette association a été créée suite à un article publié en 1979 dans Le Monde, à la page débats, avec pour auteur Michel Landa, quelqu’un peu connu du grand public. Dans cet article, intitulé « Droits », il revendiquait pour les grands malades, les personnes âgées et les grands infirmes, le droit de mourir au moment et selon les modalités choisis. Michel Landa ne s’attendait pas du tout à ce que son article ait un grand retentissement. Il a reçu un énorme courrier. Du coup il a fondé l’ADMD en 1980.
Je tiens à préciser que j’avais déjà écrit un article sur ce sujet dès 1974, dans la revue internationale Concilium, où je disais que, de mon point de vue de théologien, l’euthanasie volontaire n’était pas forcément contradictoire avec la foi chrétienne.
Quand j’ai dû chercher du travail, j’ai eu la chance d’être embauché comme employé de bureau à l’ADMD. À partir de 1984, j’ai travaillé pendant onze ans à plein temps pour cette association, ce qui me donne une expérience très peu répandue de contacts avec des dizaines de milliers de personnes, par lettres et appels téléphoniques, sur la question de l’euthanasie volontaire.
ANV : L’un des arguments invoqués pour critiquer la démarche de l’ADMD est de dire que c’est une démarche volontaire de la personne concernant sa vie et sa mort ; que faire alors avec ceux qui n’ont pas statué par rapport à cette démarche volontaire ?
J. P. : Vous posez là un problème de civilisation qui est très important. Nous avons inventé en cinquante ans une nouvelle phase de l’existence qui n’existait pas auparavant : la période parfois très longue qui s’écoule entre le début et la fin d’une maladie mortelle ou d’une grande vieillesse. Chacun d’entre nous doit l’intégrer maintenant dans son schéma vital. Actuellement on prépare sa retraite, et même ses funérailles. Il y a de plus en plus de publicité à ce sujet ! Les gens préparent également ce qui passe après leur mort (enterrement, testament…), mais ni la société ni la plupart des individus n’ont intégré dans leurs représentations la longue période qui précédera leur mort. Ils prévoient comment doit être fait le cercueil, mais ils ne songent pas, ou ne veulent pas penser, à ce qui pourrait rendre opportunes les circonstances de la mort.
ANV : Il y a aussi toute la dimension métaphysique, toutes les questions qu’on se pose par rapport à l’après-vie ?
J.P. : Pour l’après-vie, qu’on croie ou non à une vie après la mort, les problèmes que je pose sont exactement les mêmes.
ANV : Je n’en suis pas certain. Dans le vécu profond de l’individu, je ne pense pas qu’ils soient les mêmes. Techniquement, concrètement, oui, mais pour ce qui concerne le vécu profond de l’individu, je ne sais pas. Il y a un mot qui est commun à votre association et à notre travail à Alternatives non-violentes, c’est le mot « dignité ». Quand nous cherchons à donner une définition simple de la violence, quitte à s’expliquer ensuite un peu plus, nous disons sommairement que la violence est ce qui attente à la vie et à la dignité d’autrui. Expliciter la violence en termes de ce qui attente à la dignité, c’est à la fois notre vocabulaire et le vôtre. En quoi, selon vous, y a-t-il atteinte à la dignité, donc violence, lorsqu’on force quelqu’un à vivre contre son gré ?
J.P. : Je suis très heureux de cette question posée en ces termes ! Elle va me permettre de restituer différents problèmes dans un continuum de pensée. Je vais considérer trois étapes :
- la lutte contre la douleur ;
- le droit à l’acceptation du traitement ou son refus ;
- l’euthanasie volontaire et le suicide assisté.
1) Dans le problème de la lutte contre la douleur, la question de la violence est assez facile à cerner. Quand on soigne la maladie de quelqu’un, et qu’on ne soigne pas sa douleur, on lui fait violence. On dit actuellement que le problème de la lutte contre la douleur est réglé. Il ne l’est qu’en théorie. La lutte contre la douleur commence à s’améliorer dans la pratique pour les phases terminales de l’existence.
Mais, pour les choses normales de la vie, qui s’accompagnent de douleurs, on fait violence aux gens en les obligeant à souffrir des douleurs dont on pourrait les dispenser. Les dentistes ont fait dans ce domaine des progrès remarquables. Comme le faisait remarquer un de mes amis : « Les patients peuvent changer de dentiste quand il leur fait trop mal, mais les hospitalisés ne peuvent pas changer de médecin. » Ne pas supprimer une douleur alors qu’on peut le faire, c’est violer le droit à ne pas souffrir. Quand une personne hurle de douleur, c’est dégradant pour elle, pour l’entourage et le personnel médical.
2) La deuxième violence, c’est celle que l’on fait à quelqu’un en lui donnant un traitement dont il ne veut pas, ou quand on lui refuse un traitement qu’il aurait voulu.
Prenons un exemple relatif à l’ablation de la prostate. Des chirurgiens recommandent l’ablation de la prostate, mais, souvent, ils ne se donnent pas la peine de prévenir le patient qu’il n’aura plus d’éjaculation normale. On a quand même le droit de savoir, le droit d’accepter et de refuser ce genre d’opération. En Italie, un médecin a été condamné à deux ans de prison ferme parce qu’il avait mis un anus artificiel à une personne de 92 ans, qui avait refusé très explicitement, et à plusieurs reprises, qu’on lui mette un anus artificiel. Le médecin l’a fait quand même. Il a récolté deux ans de prison ferme. Il existe un droit à connaître la vérité. La non-communication de la vérité est une violence, une atteinte à la dignité.
Les textes réglementaires de la médecine française sont en gros progrès. Je cite dans mon livre l’exemple d’un homme qui a une gangrène diabétique et à qui on devait faire l’amputation d’une jambe. Il a refusé cette amputation en disant : « Moi je préfère mourir plus tôt avec mes deux jambes que de survivre avec une seule jambe. » Le juge, cela se passait en Angleterre, lui a donné raison ! Il a interdit au médecin de pratiquer l’opération. Voilà une pratique non-violente !
ANV : Ce qui est aussi important pour vous, c’est le droit à l’euthanasie et au suicide assisté.
J. P. : Oui, mon troisième point est relatif à la demande d’une euthanasie volontaire ou d’un suicide assisté. Je prends l’exemple d’une personne atteinte du sida qui a contracté une assurance-vie en faveur de son compagnon, et qui a demandé un acharnement thérapeutique maximal pour qu’il puisse tenir au moins deux ans après avoir contracté son assurance. Les médecins lui disaient : « Mais enfin, vous vous faites souffrir, vous vous condamnez à des traitements impossibles. » Il répondait toujours qu’il voulait tenir deux ans. On aurait fait violence à ce Monsieur en ne lui apportant pas l’acharnement thérapeutique maximal. Mais inversement, la personne dont j’ai parlé et qui refuse, pour le moment, de s’engager dans le cycle des chimiothérapies, aurait été violentée si on l’avait obligée à subir des chimios.
Il y a un autre cas de figure très éloquent : celui de l’alimentation forcée quand des gens font une grève de la faim. Un certain nombre de personnes âgées, par exemple, se laissent mourir de faim parce qu’elles n’ont plus aucune envie de vivre. Elles ne s’alimentent plus du tout. On a le droit de leur donner à boire, parce que la déshydratation entraîne de graves douleurs. Mais c’est une violence de les nourrir de force, exactement comme c’est le cas pour les grévistes de la faim. Or le droit international spécifie qu’il est interdit de nourrir de force des grévistes de la faim, mais il n’y a rien au sujet des autres personnes qui ont décidé de se laisser mourir de faim volontairement.
ANV : Le principe de la non-assistance à personne en danger est-il un argument qu’on oppose parfois ?
J. P. : Bien sûr, mais je dis que le danger peut avoir deux faces possibles. Si je tombe sur une personne qui a fait une tentative de suicide, je me dois de l’aider ; la loi de non-assistance en danger est une très bonne loi. Mais pour la personne qui ne veut pas de chimiothérapie, c’est quoi le danger pour elle ? Le danger, c’est qu’on l’oblige à vivre !
Beaucoup de personnes refusent de « survivre à leur propre mort», pour citer une très belle expression de Thomas More. Il existe des gens qui ne veulent pas, en effet, « survivre à leur propre mort ». À mon avis, c’est pour cette raison que des médecins peuvent très bien pratiquer l’euthanasie — notez bien que je ne dis pas la décider —, car participer à l’exécution d’une euthanasie ou d’un suicide assisté, c’est aider la personne en question à faire ce qu’elle veut. Inversement, ce sont les médecins qu’il faudrait poursuivre quand ils ne respectent pas la volonté de leurs patients.
ANV : L’ADMD préconise que les personnes qui le désirent fassent une déclaration concernant leur désir pour leur fin de vie.
J. P. : Il y a déjà des pays où cette déclaration a valeur légale. Elle n’a actuellement en France qu’une valeur morale. Des personnes qui réfléchissent sur les lois nous disent qu’il faudrait s’assurer au préalable de l’équilibre psychique de ceux qui font une telle déclaration. Mais quand Jospin, Chirac ou Sarkozy se sont présentés à la présidence de la République, on ne leur a pas fait passer un examen psychiatrique pour savoir quel était le contenu caché de leur demande ! Personnellement, je pense qu’une déclaration sur la fin de vie ne peut jamais être un acte impulsif. J’observe que les gens qui la font en ont parlé souvent depuis des mois ou des années à leur médecin, avec leur famille. L’ADMD demande toujours, c’est important, une demande lucide, réitérée chaque année, pour l’euthanasie volontaire ou le suicide assisté.
Quand nous demandons qu’une telle déclaration soit reconnue par la loi, on ne demande ni plus ni moins ce que la loi préconise à propos d’un testament, pour léguer ses biens matériels, son corps à la science… Nous demandons seulement que la loi reconnaisse les volontés exprimées par une personne et en tire les conséquences, c’est-à-dire dépénaliser l’aide, que celle-ci soit médicale ou non-médicale.
C’est à chacun de préciser sur sa déclaration les critères qu’il se fixe pour avoir recours à l’euthanasie volontaire ou au suicide assisté. Le fondateur de l’ADMD s’était donné comme critère que le jour où il ne pourrait plus faire sa toilette lui-même, qu’il serait complètement dépendant d’autrui pour celle-ci, ce serait attenter à sa vie que de le laisser vivre. Chacun doit décider des conditions de sa vie. Au fond, notre histoire à tous est analogue à l’expression « femmes dans la détresse » pour l’interruption volontaire de la grossesse ; ce n’est pas la loi qui détermine les cas de détresse. Il suffit qu’une femme se déclare en état de détresse à cause d’une gros sesse survenue alors qu’elle ne l’attendait pas, pour qu’elle puisse bénéficier de l’acte médical désiré. La loi n’a pas à faire un catalogue des situations de détresse.
ANV : Pour quelles raisons 73 % des adhérents à l’ADMD sont-elles des femmes ?
J. P. : Il existe deux raisons : l’une est que dans notre société, les grands malades, les grands infirmes, les grands vieillards sont soignés par des femmes. Que ce soit au plan professionnel ou familial, ce sont les femmes qui portent les difficultés quotidiennes sur leurs épaules. L’autre raison tient à ce que les femmes ont un rapport différent de celui des hommes au sujet de la question de la vie et de la mort : elles sont habituées à ce que leur corps se transforme.
Le coté démographique ne joue pas beaucoup puisque, parmi nos adhérents de moins de cinquante ans, le pourcentage est le même entre les hommes et les femmes.
« Mourir, cela n’est rien. Mourir, la belle affaire ! Mais Vieillir… » Jacques BREL (1929-1978)
ANV : Que faites-vous de l’argument de certains croyants qui affirment que la vie et la mort n’appartiennent qu’à Dieu ?
J. P. : Il existe également une version laïque sécularisée de cette opinion qui affirme que la vie n’appartient qu’à la vie. Nul n’aurait alors le droit d’y toucher. Ceci étant dit, je précise que je suis croyant. Et à ce titre je trouve impoli et même blasphématoire à l’égard de Dieu de soutenir que Dieu donne la vie et la reprend ensuite. Ce qui est donné est donné.
Si Dieu est Dieu, il est le meilleur des donateurs, et donc son don constitue le récipendiaire du don dans son autonomie. Il existe alors une relation d’alliance entre l’homme et Dieu. Pour moi, Dieu donne la vie, et donc cette vie est à moi pour le meilleur et le pire.
ANV : À mon avis c’est plus subtil chez certains croyants qui estiment que ce serait attenter à la volonté de Dieu que de vouloir décider d’une euthanasie, car c’est lui qui devrait décider le « moment d’être rappelé à lui ». Il y a une économie du don que vous évoquez si bien, mais que faire de l’économie de la volonté de Dieu ?
J. P. : Quand quelqu’un a une gangrène et que vous lui coupez la jambe, c’est quoi la volonté de Dieu ? C’est comme les gens qui disent : « Il faut laisser faire la nature. » Il ne faudrait alors prendre aucun médicament durant toute sa vie ! Si vous reconnaissez à des malades le droit d’accepter ou de refuser des traitements intensifs, où est la volonté de Dieu là-dedans ? Dans le traitement intensif ou dans l’absence de ce traitement ? Je crois pour ma part que Dieu est à côté de la personne qui fait l’un ou l’autre choix.
Entretien réalisé par Anne-Brigitte Lambert, Jean-Marie Muller, Bernard Quelquejeu et François Vaillant.
Transcription : Bernard Boudouresques