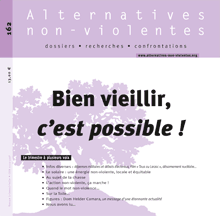La mission que s’assignent les soins palliatifs et l’expérience qu’il ont désormais accumulée permettent d’affirmer qu’ils sont un élément puissamment civilisateur du mourir.
Avec les soins palliatifs, la non-violence trouve l'une des ses plus éminentes formes d'accomplissement. Sans doute la formation des personnels soignants et les moyens à déployer nécessitent encore des progrès et le bénévolat d’accompagnement n’est pas à la hauteur des besoins d’une société où croissent les solitudes. Mais la mission que s’assignent les soins palliatifs et l’expérience qu’il ont désormais accumulée permettent d’affirmer qu’ils sont un élément puissamment civilisateur du mourir. Dissipons un malentendu possible : les soins palliatifs n’offrent pas une réponse, une solution à l’affrontement irréductiblement solitaire et singulier de chacun face à sa propre mort. Apprendre à mourir est une tâche que les philosophes se sont toujours proposés, non pour cultiver l’angoisse morbide devant l’échéance inéluctable mais pour assumer lucidement l’existence humaine dans sa finitude et lui donner ainsi authenticité et densité.
Le mouvement des soins palliatifs poursuit une tâche plus modeste mais précieuse : permettre à chacun de vivre jusqu’à la mort en évitant les violences multiformes qui trop souvent accompagnent sa survenue. On proposera ici une lecture de la problématique de ce mouvement et de ses enjeux, après un bref détour par le contexte de leur naissance.
Le mouvement des soins palliatifs a été porté par des hommes et des femmes sensibilisés dans les années soixante-dix aux conditions désastreuses du mourir et engagés lors des décennies suivantes dans une militance pour mettre fin à des situations intolérables : l’abandon des malades, au motif qu’on ne pouvait plus les guérir ; l’excès de médicalisation conduisant à l’acharnement thérapeutique ; les souffrances non soulagées ; la mort qu’on administrait, le plus souvent clandestinement, à l’aide des cocktails lytiques. D’où l’émergence de deux courants très distincts : l’un qui défendait la liberté de recevoir la mort et ce fut la création de l’ADMD (Association du droit de mourir dans la dignité), l’autre qui considérait que l’euthanasie, consentie ou non, n’était pas la manière la plus humaine de terminer la vie, ni pour le sujet, ni pour celui qui était appelé à donner la mort, ce geste étant lourd d’une violence qui ne disait pas son nom. Le mot euthanasie, qui n’avait jamais signifié autre chose que la mort douce, conformément à l’étymologie, recevait au XXème siècle une acception inédite : donner la mort. Les deux courants de pensée, qui se sont développés de manière parallèle ont contribué à une prise de conscience des problèmes de la fin de vie, mais d’une manière divergente : le premier, occupé essentiellement par la propagande en faveur de la légalisation du suicide assisté et de l’euthanasie, a contribué à aiguillonner par contrecoup le second dans la recherche de solutions alternatives et c’est alors que sont nées des structures inscrivant les soins palliatifs et le bénévolat d’accompagnement dans la société française. C’est ainsi que furent créés l’ASP (Association des soins palliatifs), JALMALV (Jusqu’à la mort accompagner la vie), la SFAP, (Société française d’accompagnement et de soins palliatifs) et d’autres associations œuvrant dans la même direction. Sans esprit polémique, mais pour être en conformité avec la réalité historique, il importe de dire que ce ne sont pas les militants de la légalisation de l’euthanasie qui ont concrètement procédé à la mise en place concrète des structures des soins palliatifs, mais la réalisation de ce dessein a été, massivement, l’œuvre de ceux qui ont refusé le raccourci que proposait la légalisation de l’euthanasie.
La culture palliative peut s’énoncer en cinq principes qui rejoignent ceux de l’éthique non-violente : le refus de l’obstination déraisonnable, le soulagement de toutes les douleurs pour le malade en phase terminale, l’accompagnement de la personne qui relève du non abandon et du devoir de fraternité, la liberté du patient correctement comprise et enfin l’interdit de l’homicide.
Le refus de l’obstination déraisonnable
La notion d’acharnement thérapeutique a surgi dans les années soixante-dix quand on s’est avisé que certains traitements pouvaient être entrepris ou continués dans un activisme médical n’ayant d’autre signification que le refus de l’échéance pourtant inéluctable.
Consentir à la mort qui vient quand le temps est venu, c’est un impératif éthique que la philosophie (comme la théologie) depuis des siècles, ne cesse de proclamer. Ce n’est pas la vie qui doit être préservée, organe par organe, c’est la personne humaine. Pas d’obstination déraisonnable (terme plus adéquat que celui d’acharnement thérapeutique), cela signifie que le temps du mourir est un temps à respecter. Il convient donc d’éviter l’allongement de la vie à n’importe quel prix, avec n’importe quel moyen. Ce serait la prolongation de la survie et ce serait irrespectueux vis-à-vis du vivant humain que l’on prétend accompagner jusqu’au bout. C’est une certaine médecine de la performance, confondant sa mission de soin avec celle de l’allongement de la vie, qui est responsable de cette dérive, au rebours de toute une tradition morale et religieuse.
Il est donc erroné de prétendre que la prolongation de la vie à tout prix soit le premier devoir du médecin. Ce qui fait problème dans cette affirmation est l’expression « à tout prix ». Une tradition multiséculaire, venue de la théologie et de la philosophie, l’atteste. Ainsi, dès le XVIème siècle, des théologiens assuraient que personne ne devait se sentir tenu d’accepter un acte chirurgical important, comme l’amputation d’un membre. Cette condamnation a été réitérée, mais peu entendue, par Pie XII, un pape peu suspect de laxisme moral, dans son « Discours sur la réanimation » du 24 novembre 1957, quand il jugeait légitime dans certaines situations l’arrêt de la réanimation. Des traitements sont « disproportionnés » quand leurs effets nocifs l’emportent sur les bénéfices escomptés.
L’obstination déraisonnable est donc une forme de violence exercée sur le corps d’autrui, qui doit être fermement combattue et il est heureux, qu’après le Code de déontologie médicale, le législateur ait inscrit son interdiction dans l’article 1er de la loi du 22 avril 2005.
Le soulagement de la douleur
Il est une autre forme de violence inadmissible, celle qui laisse souffrir le patient en fin de vie.
Le soulagement de la douleur est dû au malade incurable et en phase terminale, quelles qu’en soient les conséquences, et c’est un soin prioritaire, celui sans lequel l’accompagnement est impossible. Les meilleurs spécialistes nous disent aujourd’hui qu’il n’y a plus de douleurs rebelles, ne serait-ce qu’en raison du recours toujours possible à la sédation, c’est-à-dire à la possibilité d’endormir quelqu’un et de ne le réveiller que si on a les moyens de contrôler sa douleur. Soulager la douleur, quelles qu’en soient les conséquences, cela veut dire que si, d’aventure, les traitements antalgiques ou anesthésiants qui accompagnent la fin de vie venaient à abréger, comme conséquence indirecte de ce geste de soin, la vie d’un patient, on ne contreviendrait pas au respect de l’être humain lui-même. On se réfère souvent pour expliquer ce principe à une théorie de la philosophie morale dite du double effet selon laquelle un effet voulu, bon en lui-même, (ici soulager une douleur) peut être accompagné d’un effet mauvais (ici, éventuellement, abréger les jours du patient).
Le législateur l’a dit clairement, et en pleine conformité avec toute la tradition de la morale appliquée à la médecine, dans le deuxième article de la loi du 22 avril 2005 contre une certaine médecine négligeant le soulagement de la douleur au profit de la seule conservation de la vie. Le Code de déontologie médicale de 1947 porte la trace de cette dérive lorsqu’on lit dans l’article 23, que le médecin doit avoir « le souci primordial de conserver la vie humaine, même quand il soulage la souffrance ». Il y a eu un grand retard de la France dans le traitement de la douleur par rapport à d’autres nations comme les pays anglo-saxons. C’est le mérite du mouvement des sons palliatifs d’avoir œuvré à le combler.
L’accompagnement ou le devoir de fraternité
Le devoir de fraternité, c’est l’obligation à côté d’une assistance médicale, d’une présence humaine, toujours attentive, souvent discrète, parfois muette, dont les bénévoles (étymologiquement, les bienveillants) sont les éminents représentants. Car, dans nos sociétés atomisées, les familles et les soignants ne sont pas toujours en mesure d’effectuer seuls ces accompagnements.
Jusqu’au bout, il importe que les humains soient en relation avec les humains, que celui qui termine sa vie soit pleinement vivant jusqu’à la mort et accompagné d’autant plus fraternellement qu’il dit souhaiter en finir, le cas échéant. Il importe qu’il y ait au moins quelqu’un qui lui dise, non pas littéralement les mots qui suivent, mais l’idée qu’ils impliquent : « Ta vie compte et je n’ai pas à faire peser sur toi nécessairement ma douleur de te voir dans cet état, ma douleur de te voir t’en aller. J’ai aussi à te dire que, toi, tu comptes pour moi. ». Si un jour, l’humanité cesse de dire cela à ceux qui sont proches de leur fin, alors peut-être que nous aurons cru progresser dans le respect apparent de la « liberté » de celui qui demande à s’en aller avant le terme, mais nous aurons, plus sûrement, régressé dans la valeur qui est la plus haute de notre triade républicaine : la fraternité. Nous aurons régressé dans la « fraternité » si nous commençons, si peu que ce soit, à dire que les derniers moments du vivant ne comptent plus, qu’il est déjà exilé, parce qu’il est déjà parti, qu’il est mort avant d’être mort et que par conséquent, il peut, et même doit, anticiper son départ. C’est là une violence sournoise.
Il y a là une logique réductrice de la personne à son utilité qui mine nos valeurs les plus élémentaires et qui nous dit dans un murmure tentateur : l’agonie ne « sert » à rien, le patient en fin de vie ne « sert » à rien… Nous confondons alors le fait que la souffrance d’une personne atteinte d’un mal incurable et en phase terminale est inutile, avec la dangereuse idée que c’est sa personne elle-même qui est devenue inutile à elle-même, à ses proches et au corps social tout entier. C’est pourquoi l’interdit de l’homicide, serait-ce pour des raisons compassionnelles, est la meilleure garantie pour que soit respecté le devoir d’accompagnement. On y reviendra.
Le respect de la liberté
Le quatrième grand principe à honorer est le respect de la liberté. Et c’est un principe qui ne concerne pas seulement la fin de vie, mais chaque étape de la vie d’un malade.
Le respect de la liberté consiste à ne pas infliger à un patient un traitement auquel il ne consentirait pas de façon libre et éclairée. On ne saurait faire intrusion dans le corps d’autrui sans de graves motifs d’urgence médicale et sans s’assurer, chaque fois que cela est possible, de l’adhésion du malade aux soins qu’on lui prodigue sinon se déploierait à son encontre une forme de violence insidieuse.
Il ne s’agit pas de faire droit à l’impulsion provisoire, spontanée, d’une personne vulnérable qui manifesterait son opposition à des traitements, mais il convient, pour les équipes soignantes, de bien vérifier la nature de la demande de refus ou de limitation de traitements. Ce n’est pas rien de récuser un traitement lorsque la conséquence peut être l’abrègement des jours ; mais au bout du compte, il faut admettre que le respect de la liberté va jusqu’à faire droit à cette possibilité donnée au patient de refuser un traitement d’une façon libre et éclairée. Le législateur français a consacré le respect de cette liberté en prévoyant le cas où la personne malade ne serait plus en état d’exprimer ses souhaits : celle-ci peut désigner à l’avance une personne de confiance et rédiger ses directives anticipées et il est clairement exigé que le soignant tienne compte de l’avis de la personne de confiance nommée par le patient et des directives anticipées que celui-ci aura rédigées.
L’interdit de l’homicide
Cette liberté du patient ne va pas jusqu’à empiéter sur celle du soignant ou de l’accompagnant dont l’éthique consiste à ne pas provoquer la mort délibérément, serait-ce à la demande du patient, selon l’une des exigences fondamentales du serment d’Hippocrate aujourd’hui piétinée par les « autorisations » légales de donner la mort dans certains pays étrangers. La question doit être examinée avec attention, rigueur et humanité, car toute une philosophie du soin est engagée et que l’on résumera ainsi : accepter la mort qui survient, mais refuser de banaliser la mort administrée. Il y a, dans le débat public, beaucoup de confusions. Une chose est d’exercer sa liberté de refus de traitement, autre chose est d’exiger d’un tiers qu’il pose un geste actif de mort. Une chose est de décider d’un suicide (exercice d’une liberté personnelle), autre chose est d’exiger d’autrui qu’il accomplisse le geste homicide ou qu’il mette à disposition un poison mortel (revendication d’un droit).
Tel est donc le dernier principe sur lequel repose le mouvement des soins palliatifs : consentir à la mort qui vient, mais refuser de légitimer et donc de légaliser le meurtre compassionnel, y compris à la demande de la personne. Ce qui fait difficulté aux yeux de nos contemporains est qu’ils croient, souvent de bonne foi, que l’on devrait respecter la liberté de celui qui demande à mourir et donc que l’on pourrait, et même que l’on devrait le faire mourir si telle est sa volonté. On peut remarquer que faire mourir délibérément une personne n’est pas le même acte qu’en prendre soin jusqu’au terme : interrompre la relation de soin n’est pas la même chose que la continuer.
C’est un tournant dont nous ne mesurons pas les conséquences si nous donnons le droit de mettre fin délibérément aux jours de quelqu’un, fût-ce avec son consentement réel ou apparent. Pourquoi ? Parce que dans ce cas, le tiers, celui qui prête son concours au fait qu’une personne considère que sa vie ne vaut plus d’être vécue, celui-là vient lui dire explicitement et pas simplement implicitement : « Oui je suis d’accord avec toi, ta vie ne vaut pas d’être vécue. Oui, je suis d’accord avec toi, ta liberté l’emporte sur la fraternité que je te dois. » Il me semble que l’esprit de fraternité commande une parole d’un autre type à un suicidaire : « Je comprends ta détresse et ne juge pas la manière dont tu souhaites en finir, mais ce que tu me demandes est au dessus de mes forces et de l’attachement qui me lie à toi. Je m’engage à ce que tu ne souffres pas, à ce que tu sois accompagné. Tu me demandes de poser ou d’encourager un geste qui contredit mon désir d’être à côté d’un vivant qui vit jusqu’au bout sa vie ». Je puis témoigner que, lorsque cette parole est sincèrement et humainement prononcée, la personne, en fin de vie et désespérée, évolue dans sa demande. Dans l’immense majorité des cas, elle accepte de ne pas écourter délibérément le temps qui lui reste à vivre. Parfois, elle demande que cessent les traitements qu’elle estime devenus invasifs, inutiles et disproportionnés et ici il est éthique d’accéder à ce désir que cesse une violence intrusive. À l’inverse, quand elle est confortée par les médias ou par des militants, parfois par des proches, dans son autodépréciation, la personne s’enferme dans son désir mortifère. D’où les manquements déontologiques des médias dans le choix de leurs reportages et l’irresponsabilité éthique de certaines associations dans leurs mots d’ordre générateurs de dommages collatéraux sur les personnes vulnérables. La confusion des esprits vient d’une faute de discernement. Certains (en particulier dans les pays où l’on a cru devoir légaliser l’euthanasie ou le suicide assisté) ne voient plus très clairement la différence entre, d’une part, « consentir à la mort qui vient » (le laisser-mourir sans abandon) et qui n’est en rien l’acceptation que la vie n’est plus digne d’être vécue et, d’autre part, « provoquer délibérément la mort » (le faire mourir) au motif que la vie ne vaudrait plus d’être vécue. C’est en ce point très précis, me semble-t-il, qu’il faut réfléchir avant de rompre une digue.
Car ce n’est pas un geste d’amour le geste qui brise délibérément la relation avec celui qu’on aime : c’est au mieux un geste de désespoir, un geste peut-être inévitable parfois, jamais un geste bon. Ôter la vie de ceux qu’on aime, fût-ce à leur demande, n’équivaut pas à donner son temps, et parfois sa vie, pour ceux qu’on aime.
L’euthanasie, est une violence, une transgression de l’interdit de l’homicide, qui s’avance masquée derrière le voile de la compassion. Mais elle ne complète pas les soins palliatifs, elle les supprime. Elle ne couronne pas l’accompagnement, elle l’interrompt. Elle ne soulage pas le patient, elle l’élimine. Elle n’est pas fraternelle la « solution » qui fait cesser délibérément et avec l’approbation du corps social, la fraternité.
Pour toutes ces raisons, la logique même des soins palliatifs s’inscrit résolument dans la dynamique d’une société en quête de non-violence.