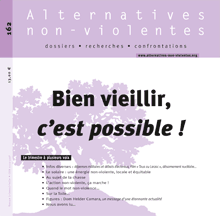La violence envers les plus faibles scandalise et émeut. Pourtant un lourd silence cache les réalités. Que cela se passe en famille ou en maison de retraite, les différents types de violences ne sont pas des cas isolés. S'il n'y a pas de tiers pour s'assurer de la préservation de la dignité d'une personne âgée, les violences peuvent se perpétuer. Bernard Faiteau met en lumière le phénomène.
Les adultes âgés subissent parfois des violences terrifiantes. Il s’agit d’un problème de société, inacceptable et bien camouflé.
Notre société est impitoyable pour les êtres faibles. La violence contre les vieux n’est pas un phénomène nouveau. Elle devrait être cependant dénoncée comme celle à l’encontre des enfants. Il n’en est rien. Un silence pesant règne autour des maltraitances sur les personnes âgées, c’est pourquoi il est extrêmement difficile d’obtenir des chiffres fiables. Une récente enquête effectuée à Boston (États-Unis), auprès de 2 020 hommes et femmes de plus de 65 ans, fait apparaître que 4,7 % d’entre elles sont régulièrement victimes de violences physiques. Ces chiffres étendus à l’ensemble des États-Unis donnent 700 000 à 1 million de personnes de plus de 65 ans victimes de sévices en un an.
Il n’existe en France aucune enquête fiable sur la maltraitance contre les personnes âgées. On ne sait pas vraiment ce qui se passe dans les familles et dans les institutions. L’association Alma (alma-france.org) estime que les maltraitances, à domicile et dans les maisons de retraite, sont pour 30 % d’ordre psychologique et pour 14 % physiques ; 9 % relèvent de la négligence active ou passive ; 32 % sont des abus d’ordre financier ; les 15 % restants intéressent d’autres maltraitances diverses.
Les médias parlent de maltraitance plutôt que de violence à l’égard des adultes âgés. « Maltraitance » fait moins barbare que « violence », mais les deux mots désignent le même phénomène : l’atteinte à l’intégrité physique ou à la dignité de la personne. Si l’on parle plutôt de maltraitance, c’est sous l’influence de directeurs d’établissements qui sont interviewés quand un problème est découvert dans leur maison de retraite. Ils cherchent ainsi à minimiser le mal en lui déniant le qualificatif « violent ».
Les adultes âgés représentent une cible de plus en plus importante quand on sait que les 80 à 100 ans sont, dans les pays industrialisés, en passe de devenir une part envahissante de la population, croissant plus vite que les jeunes, plus vite que l’ensemble des habitants.
Violences dans les familles
On observe plusieurs éléments dans la maltraitance des personnes âgées quand elles vivent dans leur famille :
- la violence est dissimulée, cachée ou niée par la victime ;
- l’agresseur est souvent alcoolique ;
- la violence du « fils ou fille adulte », qui se venge d’une maltraitance subie pendant son enfance, est fréquente.
Le récit suivant rend compte de ces paramètres :
« Une femme de 75 ans entre à l’hôpital pour une fracture compliquée de la cheville droite. En chirurgie, on lui a demandé les causes de cette fracture, ses explications ont varié : “J’ai raté une marche d’escalier — je suis tombée la nuit dernière dans ma chambre — mon pied s’est pris dans un caniveau.” Comme avec son plâtre elle était peu mobile, elle fut transférée dans un service de gériatrie afin d’être mieux suivie sur le plan médico-social. Nous avons alors appris que cette dame vivait avec son fils célibataire, 50 ans, alcoolique et en invalidité. Il avait séjourné en prison à plusieurs reprises pour des violences commises dans son travail ou contre des voisins. […] En questionnant la famille, nous avons appris que ce fils avait été dans son enfance quotidiennement rudoyé par sa mère1. »
Cette femme vivait chez elle grâce à son fils qui la maltraitait. Il agissait ainsi pour se venger, inconsciemment bien sûr, de la violence qu’il avait endurée de la part de sa mère quand lui était jeune. Il est fréquent qu’une victime soit psychologiquement dépendante de l’agresseur, et l’agresseur financièrement dépendant de la victime.
La violence dans un couple âgé résulte souvent d’un renversement des pouvoirs. Il peut arriver qu’une femme ait été soumise toute sa vie à son mari. Si celui-ci manifeste un affaiblissement à cause de l’âge, il perd de son autorité et sa femme peut en profiter pour passer d’un comportement de dominée à un comportement de dominatrice. S’il casse par exemple un verre à table, l’incident tourne au vinaigre : « Tu n’es plus bon à rien. Il faut que je te punisse. »
Les cas de séquestration existent plus souvent qu’on ne pense. Quand un vieillard vit chez l’un de ses enfants, l’argent de sa retraite est parfois confisqué par cet enfant qui, lui, n’a aucun intérêt à ce que son père ou sa mère aille en maison de retraite. Quand cet enfant est marié, que le conjoint ne supporte pas la vie commune avec la belle-mère ou le beau-père, il arrive que la personne âgée soit déménagée par exemple au garage. L’isolement peut devenir total. Ni courrier ni téléphone, absence de soins pour qu’un médecin ne voie jamais l’habitat de fortune. Le chantage est poussé parfois à son paroxysme, surtout par la belle-fille ou le gendre : « Si tu te plains encore, alors que l’on fait tout pour toi, je vais finir par te faire avaler un poison. »
Il ne faut pas que les sévices infligés à certains vieillards au sein de certaines familles fassent oublier que beaucoup d’entre elles, les plus nombreuses, s’efforcent de contribuer au bien-être de leurs anciens. Si l’on estime que 10 % de vieillards sont victimes de sévices au sein de leur famille, cela veut aussi dire que 90 % n’en sont pas victimes !
Le scandale de certaines maisons de retraite
II faut d’abord dire et souligner qu’il fait bon vivre dans la grande majorité des maisons de retraite. Des efforts considérables ont été accomplis depuis les années 1980. L’image de la maison de retraite comme mouroir est de plus en plus obsolète. La qualité d’un établissement tient d’abord à ses qualités d’accueil, aux compétences du directeur qui doit être attentif à la qualité des soins, des repas et de l’animation. Il existe cependant plus de 5 % d’établissements où des violences sont commises contre les pensionnaires. Comme en milieu familial, les maltraitances en maison de retraite sont le plus souvent secrètes, sévères, quotidiennes.
Trop de vieillards meurent pour des raisons imprécises. On les retrouve morts au petit matin. La rareté des autopsies est un vrai problème.
Les ligotages et les barrières aux lits choquent les familles et les visiteurs. Ces protections sont parfois rendues nécessaires pour des cas graves, mais leur multiplication ne devrait pas exister. Une personne peut avoir tendance à glisser de son fauteuil roulant, l’y attacher, avec son consentement, peut lui permettre de se déplacer en toute sécurité. Depuis plusieurs années, Christian de Saussure mène en Suisse une croisade contre le ligotage abusif.
« Attacher une personne, écrit-il, c’est attenter à sa liberté fondamentale et cela représente un crime. Les Nord-Américains le savent bien, et nos collègues canadiens et américains ont considérablement modifié leurs attitudes depuis que des procès se sont multipliés aux États-Unis et Canada. »
D’odieux subterfuges existent pour garder les vieillards immobiles. Un directeur d’établissement a fait scier de dix centimètres les deux pieds arrière de chacun des fauteuils de la salle de télévision. Au lieu d’être assis à leur guise, les vieillards sont basculés en arrière. Ils ne peuvent se relever que très difficilement. L’immobilité des personnes est ainsi obtenue tous les après-midi.
Nombre de maisons de retraite se disent « médicalisées », or cette notion n’est pas réglementée avec précision. Les soins pâtissent souvent du manque de personnel ou d’encadrement. Il est fréquent que des traitements ne soient pas respectés, que des escarres surgissent à cause d’un manque de surveillance. La nuit, il n’est pas rare que la surveillance de plusieurs dizaines de vieillards, dont des invalides et des personnes dépendantes psychiquement, soit assurée par une seule personne non qualifiée médicalement. Le port d’une blouse blanche n’a jamais rien prouvé ! Pour faire des économies, on recrute du personnel temporaire, non qualifié. Le manque de personnel est parfois criant; comment prendre un peu de temps pour parler aux personnes quand on est débordé par un travail délicat : toilettes, protections pour incontinents à changer… Un vieillard dépendant psychiquement peut être agressif, verbalement et physiquement…
Le manque fréquent de personnel engendre mille humiliations et vexations, aussi bien du côté des soignants que des soignés. Ce manque de personnel est récurrent surtout dans certaines maisons de retraite privées, où le prix de pension dépasse même souvent 2 000 euros par mois, rentabilité oblige, avec derrière les actionnaires qui demandent toujours plus de dividendes. Là où en France il y a un soignant pour huit résidants dans le meilleur des cas, on trouve en Allemagne, mais aussi en Autriche, aux Pays-Bas…, un soignant pour quatre ou cinq résidants. Ce n’est pas un hasard si là-bas les arrêts maladie dans le personnel sont bien moins nombreux qu’en France. Les conditions de travail n’y sont pas les mêmes. Le personnel y est mieux considéré.
Le rôle de certains médecins n’est pas toujours très clair en France, surtout dans les petites maisons de retraite à la campagne. Un maire de village a souvent intérêt, pour s’attirer l’électorat âgé, à créer un tel établissement. Le médecin et le pharmacien du village applaudissent l’initiative car le maintien des vieux dans leur village ne peut que leur profiter pécuniairement.
Quand des sévices et violences sont faites contre les pensionnaires de cet établissement, tout le monde a intérêt à se taire : le directeur a obtenu son poste grâce au maire, le médecin ne veut pas alerter les pouvoirs publics pour ne pas déplaire au maire, le pharmacien ne veut pas s’inquiéter devant le contenu de certaines ordonnances alarmantes pour ne pas se priver d’une clientèle, et, bien entendu, le personnel fautif n’est jamais au courant.
L’utilisation d’un langage trop familier, voire ordurier, existe parfois de la part du personnel soignant ou d’encadrement. L’insulte est toujours une violence. Dans le courrier reçu à l’Alma, les injures constituent une part importante des violences dont les personnes âgées se plaignent. Elles n’acceptent pas de s’entendre dire : « feignasse », « regardez-moi cette salope, elle a tout vomi ! », « paillasse », « mange-toi le cul », « si tu cries, j ‘te fous une baffe! », etc.
Bien que la gériatrie insiste depuis plus de trente ans sur les marques de respect que l’on doit aux gens âgés, il n’est pas rare d’assister au tutoiement et à l’appellation impersonnelle de « pépé » ou de « mémé ». L’atmosphère générale d’une maison de retraite dépend pour beaucoup du mode langagier employé par le personnel. L’ironie, l’injure et la méchanceté ne sont jamais parvenues à développer la cordialité et le goût de vivre.
Les vols sont monnaie courante. Les établissements sont libres d’accès et de ce fait il arrive que des petits malins y pénètrent de plein jour pour y ratisser ce qui les intéresse dans les chambres vides, à l’heure des repas ou l’après-midi quand les pensionnaires prennent l’air. Certains personnels sont également tentés par la facilité du chapardage. Quand ils sont soupçonnés, c’est toujours la même réponse : « Il fabule, il a perdu la mémoire, ce n’est pas la première fois… » Dans les établissements récents, de petits coffres sont à la disposition des pensionnaires dans leur placard.
La spoliation des biens est parfois orchestrée savamment.
« Madame M., 85 ans, veuve, vient d’entrer dans une maison de retraite privée de très haut standing. Le loyer mensuel est de 3 800 euros. La maison est confortable, et Madame M. dispose d’une belle chambre qu’elle a pu meubler à son goût. Elle a une fortune personnelle importante. Un notaire veille depuis de nombreuses années sur ses intérêts. Mais quelques mois après l’entrée de Madame M. dans cette maison de retraite, c’est un autre notaire qui, avec son accord, prend en charge cette responsabilité. Ce notaire est aussi celui qui s’occupe des intérêts de l’établissement. On apprend, après le décès de Madame M., qu’elle a légué tous ses biens à l’association (dite sans but lucratif) qui gère l’établissement et dont la présidente n’est autre que la mère de la directrice. »
Il est révoltant de voir avec quelle facilité des gens disposent de l’argent et des revenus d’autrui, sous couvert de les protéger.
La sécurité des personnes âgées n’est pas toujours honorée. Régulièrement, les médias font état de sinistres dans des établissements non conformes à leur fonction. Tout établissement hébergeant au moins vingt résidents est soumis à des inspections périodiques des commissions de sécurité. Mais seul le maire de la commune où se trouve l’établissement, ou indirectement le préfet, ont le pouvoir d’imposer leur application respective, sinon la fermeture de l’établissement. Les problèmes de sécurité interfèrent parfois avec ceux de l’emploi, avec le souci plus ou moins justifié de ne pas faire subir de déménagement aux résidents.
L’heure du repas du soir est souvent une atteinte à la dignité des pensionnaires. Il est fréquemment servi à 18 heures, parfois avant. Inadapté aux rythmes d’un adulte, un tel horaire oblige en outre les pensionnaires, qui ne peuvent se déshabiller et se coucher seuls, à s’aliter dès 19 heures jusqu’au lendemain. Il n’est pas étonnant, dès lors, qu’ils dorment mal et soient déshydratés en été. Il conviendrait que chaque établissement instaure des horaires souples, où par exemple le dîner pourrait être servi au choix entre 18 heures 30 et 20 heures, où les menus laisserait le choix entre au moins deux plats, où la participation des résidants serait requise à la composition des menus. Et puis il conviendrait de supprimer partout les plateaux-repas pour les remplacer par des couverts correctement disposés sur des tables. Trop souvent la convivialité est sacrifiée à la rentabilité. Le restaurant d’une maison de retraite ne doit pas ressembler à un fast-food, et pourtant !
C’est aux établissements à s’adapter aux résidents, non le contraire. « Monsieur P. est en maison de retraite. Il était imprésario dans sa vie active. Il est réputé avoir un tempérament agressif. Il se lève la nuit et déambule dans les couloirs. On lui pose des barrières autour de son lit pour qu’il reste couché. Rien ne va plus. Une psychologue comprend par chance les tourments de cet homme. Dans son métier, il dînait toujours vers minuit avec les artistes qu’il produisait. En maison de retraite, il ne supporte pas de devoir prendre son dernier repas à 17 heures 30. Il déambule la nuit pour chercher en vain de la nourriture. Une négociation aboutit à ce que Monsieur M. puisse se faire réchauffer, avant minuit, dans un four micro-ondes, un plateau-repas préparé de jour en cuisine. Les choses ont tellement changé pour cet homme, qu’il ne prend plus aucun neuroleptique, qu’on lui a retiré les barrières de son lit. Non seulement son comportement n’a plus rien d’agressif mais il est devenu d’une extrême cordialité avec tout le monde. »
Faut-il toujours interdire les petits plaisirs sucrés aux résidents pour qui c’est déconseillé pour leur santé, même les jours de fête ? Monsieur P., 97 ans, a des traces de diabète, le chocolat lui est donc interdit. Il ne supporte pas de voir d’autres résidents en manger à volonté. Cela le fait crier, au point de devenir violent. Cette privation, les jours de fête, ne le fait-elle pas plus souffrir que ses traces de diabète ? La maltraitance, n’est-ce pas le fait de parfois trop suivre les règles à la lettre ?
Les fêtes organisées en maison de retraite sont parfois des calvaires. On oblige les résidents à se costumer, à se grimer, à venir aux repas de fête. Il arrive qu’on les punisse s’ils boudent. Certains ne supportent pas d’être contraints de chanter régulièrement Le temps des cerises. Une personne âgée doit avoir le droit de ne pas participer à ces animations, que d’autres recherchent par ailleurs.
Des milliers de personnes vivent heureuses en maison de retraite. Pour quelques autres, c’est l’enfer. LaCharte des droits et libertés de la personne âgée dépendante de la Fondation nationale de gérontologie (1997) formule, dès son article 1 : « Toute personne âgée dépendante garde la liberté de choisir son mode de vie », y compris d’entrer ou de ne pas entrer dans une maison de retraite, et quand on y est de pouvoir en sortir.
C’est aux maisons de retraite d’agir pour que cessent toutes maltraitances et humiliations. Il faut casser la loi du silence qui les entoure. Des progrès formidables ont été réalisés depuis 30 ans pour mieux comprendre et mieux s’occuper des très jeunes enfants. Des efforts de même nature sont requis à l’égard des adultes âgés. La vieillesse ne doit plus être synonyme d’exclusion sociale. Le temps vient où la non-violence sera également à l’honneur pour les personnes âgées. Elles le méritent d’autant plus qu’elles sont particulièrement aptes à ne pas valoriser la violence. Elles savent mieux que quiconque l’idiotie des guerres, la vanité des pouvoirs, l’impasse des solutions violentes pour résoudre un conflit. S’il leur arrive parfois de « griller un fusible », c’est le plus souvent parce qu’on ne les écoute et ne les estime pas.
Certains veulent moraliser le secteur bancaire. Il semble qu’il en a bien besoin. Mais personne ne dit encore qu’il serait important de moraliser également le secteur des maisons de retraite du privé, lequel est fort lucratif pour les investisseurs. Opéra, le numéro 2 du marché français de la maison de retraite en nombre de lits, affiche pour 2008 un chiffre d’affaires en hausse de 28,7 % à 701,4 millions d’euros. En outre, Opéra a confirmé son objectif d’un chiffre d’affaires en 2011 supérieur à 1 milliard d’euros 2. « Il y a de l’argent à faire en investissant dans les maisons de retraite, mais quand je demande sur le dos de qui cela se fait, je n’entends point de réponse », se questionne un infirmier travaillant en maison de retraite 3.
1 Voir Robert Hugonot, La vieillesse maltraitée, Paris, Dunod, pp. 44-45.
2 Voir William Réjault, Maman, est-ce que ta chambre te plaît ?, Éd. Privé, 2009, pp. 158-161.
3 Idem, p. 161.
Quand une personne âgée est violentée
« Allô maltraitance des personnes âgées » (Alma) est une association à l’écoute des victimes ou témoins de violences, abus, négligences… subis par des personnes âgées, chez elles ou en établissement. Alma signale aux autorités les cas qui le justifient.
PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE NATIONALE : 3977
SITE : www.alma-france.org