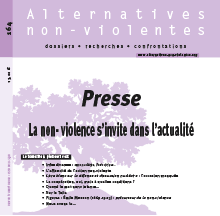Nous sommes envahis par « l’information » avec le nombre grandissant de canaux que les médias utilisent nous la faire parvenir. Pourtant, elle n’a jamais été aussi pauvre et dénaturée de son essence. Les journaux ne peuvent plus prétendre être des instruments de réflexion pour le citoyen. Bourrés de faits divers qui n’apportent aucune substance intellectuelle, ils ne font que jouer sur les émotions des gens ce qui les rend d’autant plus manipulables sur les questions essentielles de citoyenneté, notamment politique et sociale. Est-il possible aujourd’hui de réformer le métier ?

De plus en plus soumis aux lois de la concurrence et de la technique, les médias abandonnent petit à petit toute prétention à traiter l’information dignement, en respectant hiérarchie et vérification des faits. Dans une société singulièrement complexe et fragile, ils renforcent ainsi les sentiments de repli et de peur.
Si les Français sont les premiers consommateurs d’antidépresseurs en Europe, s’ils ont été classés par une récente étude comme l’un des peuples les plus pessimiste au monde, devant les Afghans et les Irakiens (étude BVA - Gallup du 3 janvier 2011), leurs médias y sont peut- être pour quelque chose.
Lire les journaux, écouter la radio et surtout regarder la télévision est une activité qui devient chaque jour plus angoissante.
Chacun d’entre nous a connu cette expérience où se mêlent le vide et le dégoût suite à la lecture d’un quotidien ou au visionnage du 20 heures. Elle résulte tantôt d’une succession de massacres et de faits-divers, tantôt d’un enchaînement de chiffres et d’analyses sur l’ampleur de la crise, le déficit budgétaire ou la montée du chômage. Dans ces deux cas de figure, le constat est le même : on a peur et on ne comprend rien. S’installe en nous la conviction que tout devient de plus en plus compliqué et que tout va de plus en plus mal.
Les journalistes ont un « devoir d’informer », nous répondra-t-on. Ce fut l’argument donné par TF1 après que la chaîne a diffusé le 8 juillet 2012 dans l’émission « Sept à Huit » et le journal de 20 heures un enregistrement des propos tenus par Mohamed Merah, qui tua notamment des enfants dans une école juive à Toulouse 1. Propos également publiés en Une de Libération mardi 10 juillet : « Moi, la mort, je l’aime... ». Que nous ont appris ces « informations » que nous ne sachions pas ? Les familles, elles, ont vécu à nouveau un cauchemar. Ce qu’il est resté de ces quelques minutes, de ces quelques phrases, ce n’est pas une information, c’est un malaise, un dégoût.
Albert Londres dénaturé
Un autre type de réponse se fait entendre lorsque certaines outrances médiatiques sont dénoncées : il faut savoir « porter la plume dans la plaie ». Cette phrase d’Albert Londres est systématiquement tronquée de son début : « Notre métier n’est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort, il est de porter la plume dans la plaie. » D’une part, il est devenu totalement désuet pour un journaliste de se demander s’il peut « faire du tort ». L’important, c’est de sortir l’info. D’autre part, cette citation répétée comme un mantra finit par agir comme une contradiction performative : les journalistes ne peuvent porter la plume dans la plaie puisqu’ils sont devenus la plaie.
Est-il bien raisonnable de comparer les enquêtes et reportages d’Albert Londres, réalisés pendant plusieurs semaines et rapportés sur plusieurs dizaines de pages dans un style très travaillé, avec des articulets d’un quart de page à l’écriture impersonnelle et froide ou avec des sujets télévisés de 30 secondes ? C’est le lot du journalisme contemporain : invoquer les principes fondateurs de la profession (l’investigation, la vérité, le risque) en les dénaturant totalement ; parler de la marche du monde, tragique et complexe, en faisant toujours plus court, toujours plus rapide. Toujours plus spectaculaire aussi.
Dans le choix des sujets et leur traitement, l’émotion prime sur la raison, le conflit sur l’apaisement, l’exhibition sur la pudeur.
La mise en scène spectaculaire de l’information, ajoutée à l’accélération de son traitement, contribuent à en faire un vecteur de violence, personnelle et sociale. Tentons d’explorer un peu plus en détail ces deux mécanismes.
Course au scoop
L'évolution des médias ces trois dernières décennies va dans le sens de l’uniformisation. Ouvrez un journal, un poste de radio ou de télé, et vous tomberez sur les mêmes sujets, souvent traités de la même façon : duel Fillon-Coppé pour la présidence de l’UMP, tweet vengeur de Valérie Trierweiler, traque de Mohamed Merah, comportement des joueurs de l’équipe de France de football, etc.
Un tel mimétisme s’explique en grande partie par des critères marchands. Pour intéresser le public, les médias ne misent pas sur l’originalité ou la prise de risque, mais sur l’idée simpliste de « faire pareil autrement ».
Partant de ce principe, l’une des façons de se distinguer et de se valoriser, c’est d’être le premier à sortir l’information. Vieux mythe du scoop, qui correspond aussi à une réalité dans les processus de promotion individuelle : un journaliste aura plus de chance de monter en grade s’il sort un scoop plutôt que s’il parle quatre langues étrangères ou que s’il est docteur ès sciences. Sur l’échelle des valeurs des rédacteurs en chef, une perfidie arrachée à Martine Aubry ou Jean-François Coppé vaut beaucoup plus qu’un reportage d’un mois au Sri Lanka.
L’accélération de l’information a été encouragée par l’irruption des nouvelles technologies. Avec l’apparition d’Internet, la diffusion est devenue quasiment instantanée : aussitôt qu’un événement arrive, il est rendu public. Ce qui pose le problème de la vérification des faits. Cette étape indispensable au bon fonctionnement d’une rédaction se voit de plus en plus reléguée au rayon des accessoires. D’où la récurrence des « affaires » (Outreau, RER D...).
La technique contre l’éthique
Les rédactions auraient pu trouver dans l’arrivée d’Internet une raison de faire valoir leur professionnalisme en garantissant au public une information fiable et vérifiée, un peu à la manière des labels qui sont apparus dans l’alimentation. Mais au lieu de se démarquer de sites amateurs où la sensation est la règle, elles les ont suivis. Le journaliste français a cette particularité d’être panurgique et corporatiste, fermé à l’autocritique. Les rédactions ont choisi de poursuivre sur la voie de la précipitation et d’aller dans le sens de la technique plutôt que de l’éthique...
L’enchaînement d’informations qui défilent comme autant d’étoiles dans un ciel nocturne nous fascine autant qu’il nous inquiète. Jamais le public n’a autant regardé la télévision (près de quatre heures par jour) et jamais il ne l’a autant défiée, critiquée. Le besoin de réfléchir, d’approfondir, d’interroger, de respirer est d’autant plus présent que notre monde devient sombre et complexe.
Le paradoxe veut que plus les techniques de communication se développent, plus notre environnement semble nous échapper, et notre isolement s’accentuer. Mondialisation, finance, crise, chômage, réchauffement climatique, construction européenne : combien de Français sont aujourd’hui capables d’expliquer ces phénomènes et d’avoir sur eux un point de vue clair et précis ?
La plupart des journalistes eux-mêmes ne comprennent rien à ce dont ils parlent. Pas les moyens, pas le temps. Que l’un d’eux réclame quelques jours pour lire ou réfléchir, sans produire, et son rédacteur en chef croira à une blague...
La leçon de Camus
Quand il décida d’arrêter le journalisme, Albert Camus expliqua qu’il était lassé de la place prise par les jour- naux à sensation, tel France-Soir. Il se désolait alors : « Le ricanement, la gouaille et le scandale forment le fond de notre presse 2. » La disparition récente de France Soir ne suffirait pas à le réjouir s’il se trouvait encore parmi nous ! Le fait-divers est partout. S’il peut se justifier parfois, quand son traitement permet de sortir du cas particulier pour en tirer, sans voyeurisme ni morbidité, des enseignements sur notre société et nos mœurs, ce n’est que très rarement le cas (citons par exemple les chroniques de feu Frédéric Pottecher à la radio, modèles du genre).
Combien de journaux télévisés, de flashes de radio, de Unes de quotidiens sur des événements sordides rapidement survolés et aussitôt oubliés, nous laissant en mémoire un goût amer ? Tempêtes, meurtres, accidents... tout est bon pour faire grimper l’audimat.
La pratique du fait-divers, dans un contexte où la vérification devient de moins en moins garantie, peut avoir des conséquences tragiques. Il faudrait prévenir les étudiants en école de journalisme : l’information peut tuer. Citons simplement ces personnes innocentes qui se sont donné la mort après avoir été dénoncées comme étant des criminels, photos à l’appui, dans un journal national ou local, avant que les faits ont été établis et jugés ? Rappelons que dans l’affaire d’Outreau, l’un des innocents accusés à tort, François Mourmand, 32 ans, est mort en prison d’une surdose de médicaments. Sa mère, sous le choc, est morte un an après 3. Le fait-divers entraîne le fait-divers. Si la justice est en partie responsable, cela n’exonère en rien les médias qui bâclent leur travail et n’exercent pas leur fonction de contre-pouvoir.
Politique spectacle
Un autre domaine, moins sombre, donne également lieu à une mise en scène spectaculaire de l’information : la politique. Cela concerne la presse écrite autant qu’audiovisuelle. Si l’on fait la somme de tous les sujets consacrés à la vie politique française dans une année, on constate que l’immense majorité touche à des questions de conquête du pouvoir ou de rivalités personnelles.
Les journalistes politiques se passionnent pour les polémiques, duels et trahisons. En revanche, rien ou presque sur les questions — vraiment politiques — de santé, de pauvreté, de protection sociale, d’écologie, de bioéthique...
Dès qu’un sujet sérieux doit être traité, on appelle un « expert », on lui pose trois questions et basta. En revanche on peut consacrer des heures d’antenne et des dossiers entiers au tweet de Valérie Trierweiler...
À force de présenter la politique comme une scène de théâtre où se jouent des destins personnels plutôt que collectifs et où l’ambition individuelle prime sur les enjeux sociaux, il n’est pas surprenant de voir monter un peu plus chaque année le taux d’abstention et le vote pour l’extrême droite, qui se nourrissent du rejet de la classe politique. Dans leur éditorial du numéro de printemps 2012, Patrick de Saint-Exupéry et Laurent Beccaria, directeurs de la Revue XXI, expliquent pourquoi ils ont fait l’impasse sur les élections : « (...) les quotidiens, les sites d’info et les news français paraissent déconnectés du réel. Ils parlent aux politiques dans un entre-soi dont les lecteurs sont des spectateurs désabusés. »
Il n’y a aujourd’hui que cinq journalistes attachés à suivre les travaux de l’Assemblée nationale, là où se joue l’avenir du pays, tandis que des bataillons passent leurs journées à déjeuner, dîner et cancaner avec les caciques des partis politiques et conseillers de ministres, en quête de la petite phrase qui va être reprise et com- mentée pendant des jours 4.
Le joli nom de « média »
Le téléspectateur, l’auditeur, le lecteur forment le public ébahi d’un monde qui se transforme de toutes parts, qui leur échappe et les écrase. L’information génère au mieux le fatalisme, au pire le pessimisme. Ce qui peut expliquer en partie la montée de réflexes identitaires, protectionnistes, guerriers.
Dans un tel contexte de précarité, de peur et de repli, le joli nom de « média » en vient à perdre tout son sens. Il devrait être — il a été — le lieu de rencontre entre divers publics, par un travail journalistique mêlé de curiosité, de risque et de rigueur : présenter aux lecteurs urbains l’évolution du monde rural, aux Français des faits qui se déroulent en Alaska, aux ouvriers des réflexions de philosophes, aux étudiants des récits d’écrivains, etc. Le média bien conçu fait œuvre de lien social. C’est avec cette conviction qu’est né Le Monde, après-guerre, sous l’impulsion de De Gaulle et Beuve-Méry.
Soumis aux principes d’accélération et d’exhibition spectaculaire qui suscitent l’angoisse et proposent le vide, les médias ont abandonné leur mission de lien social. Ils incitent plus à l’isolement qu’à la rencontre, à la protection qu’à la prise de risque, au repli qu’à la découverte, à la défiance qu’à l’engagement.
Tandis que le journal nous raccrochait au monde et nous le faisait aimer, il nous en éloigne et nous en dégoûte. Internet, lieu de tous les réseaux, aidera-t-il les journalistes à renouer avec la noblesse de leur profession ?
1) On peut écouter à ce sujet la chronique donnée par Philippe Meyer sur France Culture mercredi 11 juillet, disponible ici.
2) Albert Camus, une vie, par Olivier Todd, éditions Gallimard.
3) Lire à propos de cette affaire : Innocents, de Patrice Trapier et Anne-Laure Barret, éditions Calmann-Lévy ; et sur « l’affaire Grégory Villemin », le remarquable livre de Laurence Lacour, Le bûcher des innocents, éditions les Arènes .
4) L’émission « Le secret des sources » du 30 juin 2012, sur France Culture, a été consacrée en partie au journalisme parlementaire, disponible ici.