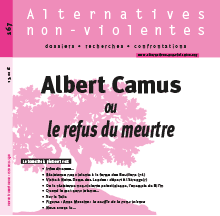La rupture entre Sartre et Camus, qui vint des attaques des Temps modernes contre L’Homme révolté , en mai 1952, met en évidence leur opposition radicale sur la question de la violence.
Pour le milieu sartrien, très proche des intellectuels marxistes de l’époque, la violence dans l’histoire était non seulement nécessaire, mais légitime, dès qu’elle se paraît de l’adjectif révolutionnaire. Ce terme, à lui seul, abolissait tout appel à la révolte. En accordant à la révolte une légitimité qu’il refusait à la révolution, en raison de l’usage généralisé de la violence depuis la Terreur de 1793, Camus se montrait infidèle à cette prétendue loi de l’histoire qui devait accoucher dans la douleur la justice sociale à venir. Mais il y a plus grave que la substitution sémantique d’un terme à un autre. Les sartriens reconnaissaient dans la pensée de Camus ce qui faisait défaut à leur système implacable : la générosité, au sens cartésien du terme, c’est-à-dire l’estime de soi-même et l’amour des autres. Leur ressentiment envers Camus n’en fut que plus âpre.
Chez Camus, comme chez Descartes, cette générosité était inscrite naturellement, non pas dans l’histoire, mais dans l’ordre du monde. Sartre, au contraire, était aussi indifférent au monde, dont la contemplation provoquait sa nausée, qu’à la fidélité à soi et à l’exigence de justice. Que Sartre ait cru bon de s’ériger en procureur, pour condamner Camus sans appel, témoigne de la violence d’une abstraction qui cachait mal son impuissance àcomprendre ses adversaires. Le jeune Camus avait déjà remarqué, à propos de La Nausée,que « la théorie fait du tort à la vie 1 », et décelé chez Sartre, à propos du Mur, « un certain goût de l’impuissance, au sens plein et au sens physiologique 2 ». Tout Sartre se tient effectivement dans son impuissance devant la réalité et les autres hommes — « l’enfer, c’est les autres » — alors que tout Camus tient dans sa puissance de vie et d’amour, ce qu’il nomme les noces de l’homme et du monde.
Avant même la rupture avec Sartre, Camus avait récusé « ce jouet malfaisant qui s’appelle le progrès 3 » et rejeté « les puissances d’abstraction et de mort 4 » qu’implique tout système idéologique. Quand Camus écrivait, dans « Les amandiers », qu’il n’était pas assez rationaliste « pour souscrire au progrès, ni à aucune philosophie de l’Histoire 5 », il s’excluait de lui-même des cercles sartriens et marxistes. Sartre ne pouvait comprendre un tel refus et, au lieu de célébrer l’amour sur l’autel du monde, il préféra sacrifier le monde sur l’autel de l’histoire. L’Homme révolté, en 1951, avait déjà répondu à Humanisme et terreur de Merleau-Ponty, qui condamnait en 1947 la « violence rétrograde » de la bourgeoisie au bénéfice de la « violence légitime » du marxisme ; par la seule magie de l’Histoire, la révolution allait faire surgir «la raison de la déraison ». Camus n’admettra jamais cet «égarement révolutionnaire»auquel Sartre succombera à son tour, et qui lui paraissait issu de « la méconnaissance systématique de cette limite qui semble inséparable de la nature humaine 6 ». Pour Sartre, il n’y avait pas plus de nature humaine que de limite. Aussi fut-il d’autant plus violent à l’égard de ses ennemis qu’il était étranger à la mesure et, par là-même, à la justice. Lors de l’affaire Henri Martin qui vit en 1953 « l’acte de rupture d’un bourgeois avec sa classe », Sartre avait avoué son credo manichéen après sa conversion « en langage d’Église » : « Un anticommuniste est un chien, je ne sors pas de là, je n’en sortirai plus jamais 7 . »
Lors de la guerre d’Algérie
Lors de la guerre d’Algérie, Camus ne transigea pas plus avec le terrorisme qu’il n’avait transigé avec la peine de mort. Dès juillet 1954, il avait défendu « ces enfants français abattus à coups de revolver et ces colons isolés qu’on massacre sans coup férir 8 » ; trois ans plus tard, il tentera d’empêcher que « l’anticolonialisme devienne la bonne conscience qui justifie tout, et d’abord les tueurs 9 ». Mais les disciples de Sartre se moquaient bien de la limite, de la justice ou de la bonne conscience. Dans un article des Temps Modernes d’octobre 1946, Simone de Beauvoir justifiait déjà la « violence criminelle assumée par la politique stalinienne », en attaquant les adversaires de l’URSS qui ne tenaient pas compte des « fins poursuivies » : « On ne peut juger un moyen sans la fin qui lui donne son sens […] Supprimer cent oppositionnels, c’est sûrement un scandale, mais il se peut qu’il ait un sens, une raison. Peut-être représente-t-elle seulement cette part nécessaire d’échec que comporte toute construction positive. » Sartre, plus tardivement, en viendra à surenchérir sur la terreur révolutionnaire en regrettant qu’elle n’ait pas été plus intense à époque de Robespierre et de Saint-Just. Il déclarait en effet à Michel-Antoine Burnier en février 1973 dans Actuel : « Un régime révolutionnaire doit se débarrasser d’un certain nombre d’individus qui le menacent, et je ne vois pas là d’autre moyen que la mort. Les révolutionnaires de 1793 n’ont probablement pas assez tué. »
Il fallait donc tuer, et tuer encore, en URSS comme en Algérie, pour satisfaire l’appétit de ce que Sartre nommait la « raison dialectique ». Et c’est au nom de cette raison, pour mieux édifier l’humanité, que Sartre n’hésita pas à appeler, en réponse aux articles de Camus « Ni victimes ni bourreaux » dans Combat,au meurtre des Européens en Algérie. La préface qu’il donna aux Damnés de la terre de Frantz Fanon était sans équivoque : « L’arme d’un combattant, c’est son humanité. Car, en le premier temps de la révolte, il faut tuer : abattre un Européen, c’est faire d’une pierre deux coups pour supprimer en même temps un oppresseur et un opprimé : restent un homme mort et un homme libre ; le survivant pour la première fois sent un sol national sous la plante de ses pieds 10 . » Sartre ne s’en tiendra pas là et glorifiera le terrorisme algérien qui fit, on ne l’oubliera pas, plus de morts chez les musulmans, qualifiés de « traîtres », que chez les Européens : « Ces exécutions de traîtres participent du combat révolutionnaire universel dont le FLN est en Algérie le bras séculier, et dont le caractère légitime, parce que placé dans le vent de l’histoire, possède un pouvoir absolutoire sur tous les attentats meurtriers. »
Le lecteur aura bien lu : des « attentats meurtriers », reconnus comme tels, se trouvent légitimés par un obscur appel au « vent de l’histoire » qui aurait ainsi le « pouvoir absolutoire » d’innocenter des assassins. On passe sous silence, par exemple, le massacre de Melouza par le FLN, le 28 mai 1957. En une seule soirée, les 315 habitants du village, qui soutenaient le MNA, mouvement rival du FLN, furent torturés et tués à coup de pioche, de couteau et de hache. Sartre, comme ses partisans, n’eut pas un mot devant un tel massacre de musulmans que le FLN imputa d’abord à l’armée française avant de reconnaître plus tard sa responsabilité. Du fait que l’histoire soufflait dans un seul sens, en une sorte de caricature de la providence divine, le terrorisme se voyait absous, et, plus encore, salué comme la libération de l’homme. Quant aux victimes, qui se comptèrent en Algérie par centaines de milliers, assassinés et mutilés par le FLN, Sartre n’eut pas un mot pour elles. Autant en emporte le vent de l’histoire…
En ironisant sur le fait que Camus ne voulait être «ni bourreau ni victime», et en le traitant de « faux intellectuel 11 », Sartre suivait la pente naturelle d’une haine aveuglée par une idéologie qui réclamait l’anéantissement de ses adversaires. Le sempiternel « tourniquet », qu’il discernait dans l’œuvre de Jean Genêt, où « les deux termes d’une contradiction renvoient l’un à l’autre dans une ronde infernale 12 », n’était plus celui de l’être et de l’apparaître, mais celui d’un ressentiment qui ne tournait plus que dans un seul sens, celui de l’Histoire. Pendant ce temps, le tourniquet de la souffrance tournait en d’autres lieux, mais sans mobiliser les clameurs électives qui avaient oublié l’Est. En Russie soviétique, la presqu’île de la Kolyma, explorée par Varlam Chalamov et Alexandre Soljenitsyne, n’intéressait pas grand monde parmi les intellectuels parisiens qui avaient définitivement retourné — grâce au tourniquet de leur conscience — l’indignation en faveur des victimes en approbation à la gloire des bourreaux.
Il est vrai que Sartre, comme d’autres intellectuels occidentaux, était aveuglé par le messianisme marxiste. Il devait apporter le bonheur à la fin de ce que Marx nommait la « préhistoire », l’histoire véritable de l’humanité commençant avec l’avènement du communisme. La révolution était donc nécessairement violente puisque toute rupture est une violence envers le temps passé et les hommes présents. Camus ne l’a jamais accepté, lui qui voulait, comme Nietzsche, être l’héritier du passé entier de l’humanité. On le constate dans la pièce de théâtre qu’il a nommée, par une ironie amère, Les Justes. Ceux qui se nommaient ainsi étaient des terroristes russes qui, pour accomplir leur révolution, étaient prêts à tuer des innocents. Le 15 février 1905, le poète Ivan Kaliayev devait se jeter devant la calèche du grand-duc Serge, l’oncle du Tsar, pour lancer une bombe. Il arrêta son geste quand il vit l’épouse de l’homme qu’il voulait tuer et les deux enfants qui accompagnaient le couple.
Son revirement sera mal compris par ses camarades qui lui diront : « Nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes des justes. » Et, pour Camus, les terroristes se disent « les Justes » parce qu’ils soutiennent que, contre « l’ignoble amour », « la bombe seule est révolutionnaire ». Mais, à l’inverse, Kaliayev, bien qu’il finisse par tuer le grand duc, conserve le fond de cette innocence qui fait la bonté de l’homme. « Mais c’est cela l’amour », dit-il à ses amis, « tout donner, tout sacrifier sans espoir de retour. » L’amour est toujours cet amour du bien qui est une donation étrangère à toute récompense. C’est cette gratuité du bien, et de l’amour qu’on a pour lui, qui fit la singularité de Camus parmi les siens.
Mais Sartre avait-il une morale ?
Sartren’était fait ni pour l’amour ni pour l’amitié. Après la mort de Camus, il verra en lui « un petit truand d’Alger, très marrant, qui aurait pu écrire quelques livres mais plutôt de truand 13 ». Et il dénoncera, dans son œuvre, « un combat douteux » en faveur de la morale 14 . Mais Sartre avait-il une morale ? Dans sa polémique des Temps modernes, il admettait que les camps staliniens étaient « inadmissibles » ; mais c’était pour ajouter aussitôt : « inadmissible tout autant l’usage que la “presse dite bourgeoise” en fait chaque jour ». Le scandale de l’univers concentrationnaire ne l’émouvait donc que par éclipse. Son parti pris en faveur de la révolution, de la violence et de l’injustice — pour ne désespérer ni l’Histoire ni Billancourt — forme un étrange contraste avec l’assentiment camusien envers l’homme, le monde et la vie. Camus avait pourtant mis en garde ses lecteurs : « La révolte n’est pas le ressentiment 15. » Dans toute révolte, il y a une affirmation et un consentement au monde qui, dans sa « tendre indifférence », « finit toujours par vaincre l’histoire 16 ». Et cette victoire est en définitive, pour l’homme, la victoire de l’amour.
Hannah Arendt l’avait compris qui, dans une lettre du 21 avril 1952, écrivait à Camus : « J’ai lu L’Homme révolté que j’aime beaucoup. » La philosophe américaine ne dit rien de semblable à l’égard de Sartre. Elle sentait bien que l’auteur de La Nausée était toujours resté étranger à la beauté du monde comme à la révolte des hommes. Quand on a érigé l’abstraction en violence, on ne connaît pas plus la justice que l’amour.
1) A. Camus, Alger républicain, 20 octobre 1938, Essais, Paris, Gallimard, La Pléiade, 1965, p. 1417.
2) A. Camus, Alger républicain, 12 mars 1939, Essais, op. cit., p. 1420.
3) A. Camus, « La culture indigène. La nouvelle culture méditerranéenne », 8 février 1937, Essais, op. cit., p. 1327.
4) A. Camus, « Présentation de la revue Rivages », Essais, op. cit., p. 1331.
5) A. Camus, L’Été, Essais, op. cit., p. 835.
6) A. Camus, « La pensée de midi », L’Homme révolté, Essais, op. cit., p. 697.
7) J.-P. Sartre, Situations IV. Portraits, Paris, Gallimard, 1964, pp. 248-249.
8) A. Camus, « Terrorisme et amnistie », Chroniques algériennes, Essais, op. cit., p. 1865.
9) A. Camus, Le Monde Libertaire, n° 33, décembre 1957, repris dans Réflexions sur le terrorisme, textes choisis et introduits par J. Levi-Valensi, Paris, Nicolas Philippe, 2002, p. 178.
10) J.-P. Sartre, préface de septembre 1961 à F. Fanon, Les Damnés de la terre, Paris, La Découverte, Paris, 2002.
11) Olivier Todd, Albert Camus. Une vie, Paris, Gallimard, 1996, p. 756.
12) J.-P. Sartre, Saint Genet, comédien et martyr, Paris, Gallimard, 1952, p. 238.
13) Lettre de Sartre à John Gerassi en 1972. Quant à la haine de Sartre envers ses ennemis — de Gaulle est « un maquereau réac », Malraux un « porc », Raymond Aron « un con et un imbécile », etc. — on lira, du même John Gerassi, Entretiens avec Sartre, Paris, Grasset, 2011.
14) J.-P. Sartre, à son ami Gerassi, été 1972, O. Todd, Camus. Une vie, op. cit., p. 827 ; J.-P. Sartre, France Observateur, 7 janvier 1960.
15) A. Camus, « Remarque sur la révolte », L’Existence, 1945, Essais, op. cit., p. 1685.
16) A. Camus, « Le vent à Djémila », Noces,Essais, op. cit., p. 65.